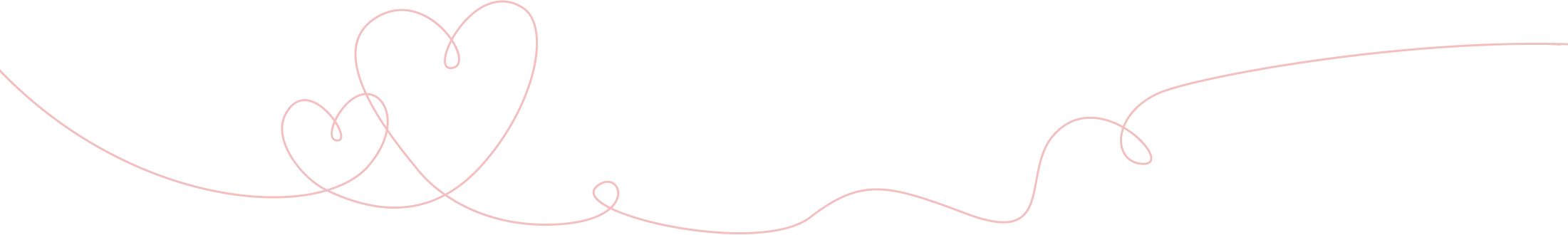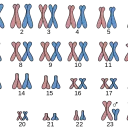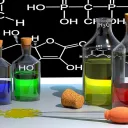- Je fais un don
- Je fais un don IFI
- Pourquoi donner ?
- Fondation RCF
- Legs, Donation, Assurance-vie
- Qui sommes-nous ?
- Les fréquences
- Nos partenaires
- Nous contacter

Eurêka · RCF Alsace RCF - page 3
Eurêka le magazine qui vous permet de découvrir et de comprendre la science.
Chaque jeudi à 12h30 et 19h30, et le samedi à 10h45 sur RCF Alsace.
Episodes
 18 janvier 2022
18 janvier 2022Les travailleurs temporaires en Europe : oiseaux de passage ?
En partenariat avec Centre national de la recherche scientifique - CNRSMarco Rocca, chercheur CNRS en droit du travail, scrute une réalité de l’Europe, celle des travailleurs migrants temporaires.
C’est un débat de société, mais aussi une question jusque là peu étudiée, peu chiffrée, peu documentée. Peut-être parce qu’on a estimé cette force de travail marginale par rapport à l’ensemble des actifs ?Pourtant, dans certains secteurs d’activité économique comme la construction, le travail agricole saisonnier, le travail en abattoir, les travailleurs migrants temporaires semblent de fait constituer une main d’œuvre constante, structurelle, permanente.
Pour savoir ce qu’il en est réellement, Marco Rocca, chercheur CNRS en droit du travail et spécialiste des mobilités au laboratoire Droit, religion, entreprise et société, DRES, une unité de recherche du CNRS et de l’université de Strasbourg, lance le projet de recherche E-BoP, financé par un projet ERC Starting Grant (1,4 millions d’euros), qui durera cinq ans : European Birds of Passage - An Empirical Legal Theory of Temporary Labour Migration in Europe - Les oiseaux de passage européens - Pour une théorie juridique empirique de la migration temporaire de travail en Europe).
Émission Eurêka ! proposée en partenariat avec la délégation Alsace du CNRS.
Plus d’informations :
Marco Rocca, chercheur CNRS en droit du travail au laboratoire Droit, religion, entreprise et société, DRES (unité de recherche du CNRS et de l’université de Strasbourg)
https://marcorocca.wordpress.com/
Musique : Obstacles de Syd Matters (Album : Someday We Will Foresee Obstacles)Droits image: Eureka 11 janvier 2022
11 janvier 2022Qu'avons-nous appris de la gestion de la crise ?
Depuis 2 ans, le monde entier fait face à une crise sanitaire inédite. Chaque pays ou presque, chaque continent a eu sa manière de gérer la crise, de répondre aux confinements répétés et aux manques divers.
Chacun a tenté de soutenir un « pays » arrêté avec des mesures plus ou moins audibles, acceptables, « assumables ». Que nous apprend une comparaison entre la France et les autres pays à travers le monde ? Partout la gestion a été caractérisée par des tâtonnements face à l’incertitude du coronavirus et de son comportement infectieux, face à la pénurie des masques et moyens de protection, face aux mesures de distanciation sociale et aux confinements… En 2011 un plan pandémie avait été mis en place tant en France qu’aux États-Unis par exemple, qui prévoyait déjà l’incertitude… Mais il n’a pas été ou pu être appliqué… La pandémie illustre une mondialisation pour le meilleur et pour le pire mais aussi la nécessité de formuler des principes et des critères éthiques pour guider la gouvernance sanitaire. L’OMS devrait ici jouer un rôle plus clair et décisif.Droits image: © Online Marketing / UnsplashLa génétique est l’étude scientifique de l'hérédité et des variations individuelles. Quel est le support de l’hérédité ? Comment les caractères se transmettent de génération en génération ? ADN, gènes, allèles, caractères dominants et récessifs, maladies génétiques… Tout cela semble bien compliqué. Au cours de cette émission, nous allons survoler ensemble tous ces concepts.
Droits image: DR 21 décembre 2021
21 décembre 2021À l’Institut du médicament de Strasbourg
En partenariat avec Centre national de la recherche scientifique - CNRSComment faire bénéficier la société des dernières connaissances issues des laboratoires de recherche publics ? A l’Institut du médicament par exemple ! Sylviane Muller, sa directrice, chercheuse immunologiste émérite du CNRS est l’invitée d’Eurêka !.
La question du transfert de connaissances des labos vers la société est devenue cruciale. Parce qu’il n’est plus question d’attendre 20 ans pour passer de l’un à l’autre, de nombreux dispositifs et entités soutiennent aujourd’hui ce transfert, aussi appelé « valorisation », qui conduit à l’innovation. Parmi ceux-ci, l’Institut du médicament de Strasbourg, IMS, une structure originale de l’université de Strasbourg, qui a pour but de faire le pont, transférer les savoirs et surtout, de nouvelles molécules thérapeutiques…
Sylviane Muller est directrice de recherche émérite du CNRS et immunologiste au laboratoire Biotechnologie et signalisation cellulaire, BSC (unité de recherche du CNRS et de l’université de Strasbourg). Après avoir reçu en 2009 la médaille d’argent du CNRS qui distingue ses travaux originaux et reconnus sur le plan international, elle a reçu en 2015 la médaille de l’innovation du CNRS. C’est avec cette double perspective qu’elle dirige depuis près de 10 ans l’Institut du médicament de Strasbourg… à la manière des motifs entrelacés du boléro de Maurice Ravel.Droits image: Sylvianne Muller- "La pandémie a surtout mis en évidence les failles du système de santé que les professionnels dénoncent depuis de nombreuses années, et le primat des soins de santé individuel et technique aux dépens des soins primaires de santé publique.
La pandémie a joué le rôle de loupe grossissante sur les mutations des systèmes de santé, elle a interrogé l’assurance maladie, le fonctionnement des établissements hospitaliers, l’adaptation des EHPAD et des lieux de vie pour les personnes avec un handicap, les services d’obstétrique… mais aussi la grille des salaires… Les politiques ont refusé de trier les patients au motif de l’absence de lits mais ont dû mettre en œuvre un tri entre patients-Covid et non-Covid pouvant plus ou moins retarder le traitement des seconds…. Qu’en avons-nous appris de ce tri ? de la saturation des systèmes de santé ? de la crise sur le plan humain, social, médical, éthique ? Quels aspects du système de santé faut-il absolument préserver ? Lesquels faut-il réformer et comment ?"Droits image: © RCF Alsace  16 novembre 2021
16 novembre 2021Cyrcé, un cyclotron à Cronenbourg
En partenariat avec Centre national de la recherche scientifique - CNRSQue contient le liquide injecté avant de faire un examen médical « PET scan » (tomographie par émission de positons) ? Des isotopes radioactifs ! Avec Patrice Marchand, radiochimiste du CNRS, nous découvrons comment ces atomes rares et éphémères sont produits pour la médecine nucléaire. Son travail scientifique nous mène tout droit au cyclotron Cyrcé, sur le campus CNRS de Cronenbourg, caché dans sa carapace de béton dans les locaux de l’institut pluridisciplinaire Hubert Curien, unité de recherche du CNRS et de l’université de Strasbourg. Grâce à cet accélérateur de particules, Patrice Marchand et ses collègues, savent très bien produire des isotopes radioactifs, comme le Fluor 18 couramment utilisé pour le diagnostic de cancer. Ils émettent, pendant une courte durée (6 h pour F-18), des positons dont l’énergie issue de leurs désintégrations sera détectée par le PET. Mais Cyrcé est différent des autres cyclotrons : il sert à la recherche et à l’enseignement. Les scientifiques y explorent donc de nouvelles voies : ils conçoivent, testent et éprouvent les isotopes de demain, pour un usage diagnostic mais aussi thérapeutique, ou même pour d’autres applications médicales. Un travail de longue haleine, qui peut prendre jusqu’à 10 ans, avant de parvenir aux tests finaux. C’est en référence à Circé, magicienne de la mythologie grecque qui avait en son temps transformé l’équipage d’Ulysse en cochons, que le cyclotron alsacien transmute des isotopes stables en espèces instables radioactives… Émission Eurêka ! proposée en partenariat avec la délégation Alsace du CNRS.
Droits image: Patrice Marchand - © RCF Alsace- Alors que plus de 80 types de vaccins sont actuellement en expérimentation à travers le monde pour contrer la covid-19, seule une poignée est utilisée pour le moment et les stratégies vaccinales dans le monde diffèrent grandement d’un pays à l’autre. Depuis les travaux de Louis Pasteur, l’on sait l’efficacité potentielle des vaccins, tout en mesurant aussi la nécessité de leur bon usage car il s’agit bien de produits médicaux qui peuvent avoir des effets secondaires s’ils sont mal utilisés. Mais jamais jusqu’à la covid-19, des vaccins n’ont été mis au point si rapidement, posant de nombreuses questions éthiques, sanitaires, philosophiques, juridiques, économiques, politiques… Quelles certitudes et incertitudes ? Quelle place nouvelle pour l’industrie pharmaceutique ? Quelles promesses pour la co-construction d’un autre monde impliquant non seulement la thérapeutique dans les phases aiguës mais aussi la prévention ? La politique de santé publique exige-t-elle la mise en place d’un passeport vaccinal/d’un passe sanitaire ? Quels repères éthiques en matière d’équité, de justice, d’égalité entre citoyens… peuvent éclairer les stratégies vaccinales à privilégier ? L’émission interroge aussi les priorités mises en place à partir des cultures qui avantagent certaines populations plutôt que d’autres.Droits image: © RCF Alsace
- Après les sucres et les lipides, nous étudions 2 nouveaux types de macro-molécules, les protéines et les acides nucléiques. Le métabolisme des être vivants est basé sur l’utilisation de 4 sortes principales de macro-molécules. Après avoir étudié les sucres ou glucides, et les graisses (ou lipides), nous allons découvrir les protéines et les acides nucléiques. MUSIQUE le chant des protéines: https://www.youtube.com/watch?v=WLGGLJ5xlBgDroits image: © RCF Alsace
 19 octobre 2021
19 octobre 2021Le Copte, langue de l'ancienne Egypte
En partenariat avec Centre national de la recherche scientifique - CNRSPour étudier les écrits coptes, Esther Garel est allée en Égypte, berceau de la langue copte, et un peu partout en Europe où ils sont dispersés dans des bibliothèques prestigieuses : la British Library, la Sorbonne, Vienne…
Avec elle, nous apprenons que cette langue des « Égyptiens chrétiens » - encore utilisée par l’Église copte au cours des liturgies - connaît ses premiers balbutiements dans les tout premiers siècles de notre ère…dans une Égypte encore polythéiste ! La motivation initiale du recours à l’alphabet grec pour écrire l’égyptien est le souci de ne pas écorcher des formules aux pouvoirs magiques, astronomiques, incantatoires... Ce n’est que plus tard, à partir du 4ème siècle, que le système d’écriture est adopté à grande échelle et que la langue devient dépositaire des textes chrétiens sacrés, traduits du grec.
Le copte joue aussi en Égypte pendant la période byzantine et le début de la période arabe (du 4ème au 11ème siècle de notre ère) un rôle très pratique ; il sert à consigner différentes informations du quotidien : lettres privées, testaments et autres actes notariés, contrats de vente, ordres de paiement, reçus de taxe, correspondances avec l’administration…autant de traces parcellaires décryptées par Esther Garel, qui aident à documenter la vie d’alors ! Des recherches récompensées par la médaille de bronze du CNRS qui lui est décernée en 2021.
Émission Eurêka ! proposée en partenariat avec la délégation Alsace du CNRS.
Plus d’informations :
Archéologie et histoire en Méditerranée et en Europe, ArcHiMèdE, unité de recherche du CNRS et de l’université de Strasbourg : https://archimede.unistra.fr/laboratoire/membres/membres-titulaires/esther-garel/
Un air d’Orient nous parvient grâce à Esther Garel, lauréate de la médaille de bronze du CNRS. Historienne et philologue, spécialiste de la langue copte au laboratoire Archimède (unité du CNRS et de l’université de Strasbourg), ses recherches en papyrologie copte sont distinguées en 2021.Droits image: Eureka- "Le choc, la brutalité de l’expérience de la Covid.19 se laisse appréhender au mieux en passant par les trois moments qui la caractérisent : la vie d’avant, la vie-pendant qui n’est pas encore terminée, et la vie de demain qui commence à se construire. L’émission étaye ces trois moments. De quoi était faite la « vie normale » d’avant la pandémie ? Ou plutôt la vie-d’avant car le concept de normalité n’est venu qu’avec la pandémie faisant advenir de tels changements que tout devenait « a-normal », c'est-à-dire en dehors de la norme de l’habitude, la norme d’une médecine victorieuse de la maladie, d’un système de santé efficace, la norme de l’individualisme… Ce qui a changé au cours des derniers 18 mois contient à la fois du positif et du négatif. Son point central est l’incertitude. Et si la société a été collectivement interrogée, elle a expérimenté à la fois la solidarité et le besoin d’aide alimentaire pour certains, un retour bénéfique à la vie de famille et une recrudescence des violences intrafamiliales… Elle découvre aussi qu’un monde meilleur, plus écologique est possible… Mais dans les 4 scénarios actuels projetant l’avenir, c’est malheureusement encore celui de l’économie et la croissance continue qui prédomine."Droits image: © RCF Alsace
- Après les atomes, nous allons décrire les molécules, et plus précisément les macro-molécules. Aujourd’hui, nous découvrons les sucres et les lipides. Les sucres ou glucides, et les graisses (ou lipides) sont des éléments essentiels au métabolisme des êtres vivants.Droits image: Eureka
 21 septembre 2021
21 septembre 2021Ça bulle et ça mousse à la Fête de la science !
En partenariat avec Centre national de la recherche scientifique - CNRSWiebke Drenckhan est ambassadrice de la Fête de la science pour la région Grand Est, manifestation qui a lieu partout en France…depuis 30 ans déjà !
Invitée de ce numéro d’Eurêka !, elle explique comment les bulles des mousses font partie de sa vie de physicienne du CNRS à l’Institut Charles Sadron. "Physicienne des mousses, c’est surprenant ? Pas vraiment ! Wiebke Drenckhan a compté pour nous : en une journée, nous pouvons croiser jusqu’à 30 mousses différentes. Ça commence tôt le matin, avec la mousse du cappuccino, du café, du lait qu’on se verse…ça continue avec la mousse de la crème à raser, la mousse d’un extincteur, la mousse au chocolat, etc. Sans compter les mousses solides : les éponges, les mousses de béton, les mousses métalliques, toutes les mousses des matériaux de construction, des isolants…
Bref, les mousses constituent des matériaux facilement identifiables et très répandus, dont les propriétés physico-chimiques sont bien comprises depuis une quarantaine d’années. Mais dont on ne sait plus rien…dès lors qu’on veut les modifier, les contrôler, les stabiliser : comment avoir des bulles de même taille dans une mousse ? comment déterminer leur position ? comment avoir une mousse qui glisse puis qui colle ? et si on veut modifier la surface d’une bulle ? Une bulle BIO, est-ce possible ? Et une bulle LBL – constituée d’un polymère élaboré « layer by layer », couche par couche, marque de fabrique de l’Institut Charles Sadron ? Vous aussi, vous pouvez poser vos questions à Wiebke DRENCKHAN et à ses coéquipiers, au campus CNRS de Cronenbourg, où est installé le village des sciences samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 . "
Droits image: EurekaAprès avoir évoqué pendant un an la thématique « Éthique et Covid » dans ses différents enjeux, la même équipe (Anne Danion, Jacqueline Bouton, Guy Freys, François Clauss et Marie-Jo Thiel) propose de continuer à en discuter pour en discerner des éléments constitutifs, à la fois positifs et négatifs : Éthique et Covid 19 : Et maintenant ? La pandémie a apporté du tragique, de l’incertitude, des discriminations, mais elle a également suscité beaucoup de solidarité, de la créativité, des attitudes nouvelles… Il faut dire que souvent aucune attitude simple, évidente, ne s’imposait. En attestent les nombreux rapports, enquêtes, témoignages divers toujours en cours d’élaboration. L’émission a ainsi choisi de revenir sur une missive très particulière et évocatrice même si tous les cas de réanimation, loin s’en faut, ne se sont pas passés de la même manière. En effet, le 7 décembre 2020, Le Monde publie une tribune qui prend la forme d’une lettre adressée par trois réanimateurs et une sociologue à Denise, décédée des suites de la Covid-19 et qui a choisi de ne pas occuper le dernier lit disponible en réanimation. Son titre est évocateur : « ‘Vous ne vouliez pas occuper cette dernière place en réanimation...’ : l’hommage ému de soignants à Denise, une patiente âgée morte du Covid-19 ». Les auteurs de la lettre rappellent des faits difficiles et expriment leur reconnaissance : « … Chère Madame, nous vous sommes gré de cette expérience médicale, humaine et sociale inédite. Nous penserons à vous à chaque situation dans laquelle une décision difficile devra être prise. Nous nous souviendrons de vos paroles et de la nécessité absolue de toujours aller à la rencontre de chaque patient pour évaluer sa situation dans toute sa singularité… »
Droits image: © RCF Alsace- Le monde du vivant se caractérise par l’empilement de différents niveaux d’organisation. Depuis l’atome jusqu’à la biosphère, le vivant se complexifie à chaque étape. Dans cette première émission, nous allons décrire les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir parler de vivant.Droits image: Eureka
- La maladie d’Alzheimer nous concerne tous, en raison de sa fréquence et sa gravité. Ses symptômes et signes ainsi que sa prévention doivent être connus de tous. Le point avec un spécialiste. La maladie d’Alzheimer est un nom qui a de quoi faire peur. Plus de 40 millions de personnes ont sont atteintes dans le monde. Elle évolue de façon inexorable selon une lente et irréversible détérioration des fonctions intellectuelles. C’est une maladie complexe qui comporte plusieurs visages et pour laquelle il existe aujourd’hui des possibilités thérapeutiques. Le professeur Frédéric Blanc, gériatre compétent en neurologie, spécialisé dans les maladies cognitivo-comportementales et les troubles de la mémoire, travaille au CHU de Strasbourg et à l’université où il enseigne et fait des recherches. Il nous apporte son éclairage de spécialiste de façon claire, agréable et synthétique.Droits image: © RCF Alsace
- Les relations entre roches et fluides (gaz ou liquides) sont complexes : frottements, frictions, écoulements…et leurs conséquences parfois spectaculaires : séismes, failles, glissements de terrain, liquéfaction des sols.Droits image: © RCF Alsace
- "La distanciation sociale a profondément bouleversé les vécus individuels et collectifs durant la pandémie de Covid-19 : elle a mis à distance mais elle a aussi paradoxalement mis en évidence des liens reconnus comme « essentiels ». Les rapports interhumains ont été profondément interrogés : utiles, dangereux, indifférents, décisifs… Selon les lieux – familiaux, sociaux, associatifs et culturels, religieux et cultuels, hospitaliers, professionnels, lieux de ravitaillements, de sortie…– selon la situation antérieure, le vécu seul dans un appartement ou une maison pour une personne âgée, un lieu étroit avec des enfants, l’éloignement de ces derniers, etc., les expériences ont été les pires et les meilleures ! Elles ont interrogé sur ce qui est vraiment « essentiel ». Mais le confinement a aussi aggravé des situations de maltraitance. Il a frustré quant aux comportements de proximité en particulier à l’occasion des enterrements ou de l’accompagnement de mourants ou de personnes en situation de handicap (Alzheimer…). De nouvelles technologies ont pris place dans les relations : tablettes, traçage numérique, etc."Droits image: © RCF Alsace
- Si l’origine de la pandémie à coronavirus n’est pas claire, les recherches suggèrent néanmoins un passage du virus de la chauve-souris vers l’humain en passant par un intermédiaire inconnu à ce jour. Plus généralement, ces recherches interrogent sur les conséquences des activités humaines, économiques et industrielles, peu respectueuses de l’environnement. On pense par exemple à la déforestation en Amazonie, à la destruction de la biodiversité partout dans le monde avec l’usage de pesticides et aux produits nocifs, aux changements climatiques induits par nos excès consuméristes, à des commerces inéquitables (quinoa en Bolivie par ex.), etc. Certes, le confinement a permis une baisse importante du dioxyde d’azote et un retour de la faune dans les villes, dont le chant des oiseaux n’est pas le moins symbolique ! La pandémie a permis de mieux comprendre notre interdépendance entre humains, mais aussi avec tous les vivants et la planète elle-même. L’initiative One Health (une seule santé) l’avait noté dès les années 2000, promouvant une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, humaine et animale et environnementale, locale et planétaire. Aujourd’hui, la maison brûle et les zoonoses se multiplieront. Comment prévenir ? La « peur spirituelle » dont parlait Hans Jonas reste d’actualité. Écho au « courage d’avoir peur » de Günther Anders… La justice écologique et environnementale doit rester au centre de nos préoccupations éthiques et inviter à une mise en pratique urgente et réfléchie. D’autant que l’état d’urgence sanitaire a été utilisé aussi pour déroger aux normes environnementales avec quelques 360 arrêtés préfectoraux rien qu’entre le 15 mars et le 25 avril 2020…Droits image: © RCF Alsace
RCF vit grâce à vos dons
RCF est une radio associative et professionnelle.
Pour préserver la qualité de ses programmes et son indépendance, RCF compte sur la mobilisation de tous ses auditeurs. Vous aussi participez à son financement !