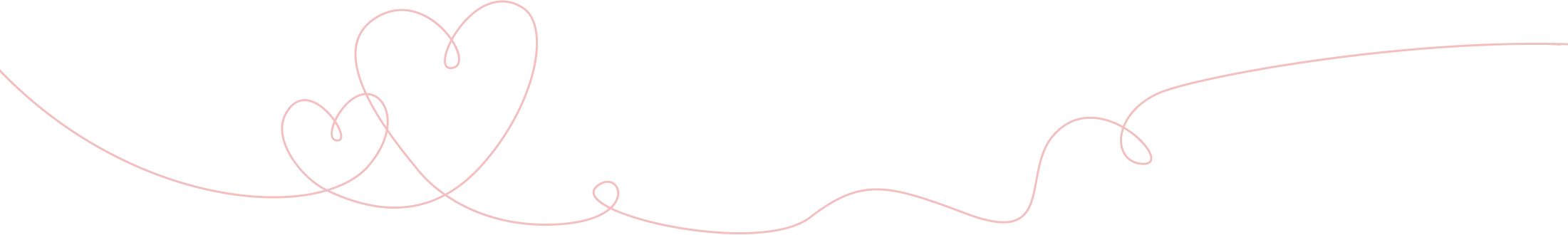Tout savoir sur l'épilepsie, une maladie encore méconnue
C’est une maladie neurologique qui concerne plus de 700.000 personnes en France. L’épilepsie touche toutes les tranches d’âge dans tous les milieux. Une maladie qui provoque des crises soudaines dues à une activité électrique anormale dans le cerveau, qui reste mal comprise, aussi bien par le grand public que par les patients eux-mêmes. Quelles en sont les causes ? Comment mieux sensibiliser la société pour améliorer la prise en charge et l’inclusion des personnes épileptiques ? Une émission Je pense donc j’agis présentée par Melchior Gormand.
 © Shvetsa / Pexels
© Shvetsa / PexelsCe qu'il faut retenir :
- L'épilepsie concerne plus de 700.000 personnes en France.
- Le diagnostic repose sur l’électroencéphalogramme (EEG) et l’imagerie cérébrale (IRM, scanner).
- L’épilepsie peut être bien contrôlée chez de nombreuses personnes grâce aux traitements.
50 millions. C’est le nombre de personnes touchées par l’épilepsie dans le monde. Un chiffre important pour une maladie aux multiples préjugés. Il s’agit "d’une maladie neurologique qui vient du cerveau, plus précisément du cortex, là où se trouvent les neurones", explique le professeur Vincent Navarro, neurologue et responsable de l’Unité d'Épilepsie de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris. Qu’est-ce que l’épilepsie et comment fonctionne une crise ? Existe-t-il des traitements ? Comment accompagner les malades et leur famille ?
Qu’est-ce que l’épilepsie ?
"Il y a autant de formes d’épilepsie que de malades", rappelle Vincent Navarro. Cette maladie neurologique, longtemps considérée comme un trouble psychiatrique, touche le cerveau, "le cœur du fonctionnement du corps", rappelle le professeur. Et cela se voit. Delphine Dannecker, présidente d’Épilepsie-France, une association de patients, parents, et professionnels concernés par l’épilepsie, se remémore : "Une crise est très impressionnante, ça renvoie à l’image de la mort." Vincent Navarro indique que "la forme la plus sévère d’une crise est lorsque tout le corps est touché par des décharges électriques. Tous les muscles se contractent, le patient convulse et tombe. C’est un phénomène très brutal, le malade perd connaissance et la crise s’arrête au bout d’une à deux minutes".
Delphine Dannecker fait part d’une autre forme de crise d’épilepsie, moins visible mais tout aussi grave : l'absence. "C'est lorsque la personne paraît dans la lune, et ne se rappelle pas du moment.” Vincent Navarro fait part d’autres “formes légères de crises comme une sensation dans l’estomac, une impression de déjà vu ou encore des troubles de la mémoire".
50 millions de personnes sont touchées par l’épilepsie dans le monde.
"Il faut parfois plusieurs mois ou années avant qu’un diagnostic correct soit fait", déplore le professeur Navarro. Pour poser un diagnostic, il se base dans un premier temps "sur l’interrogatoire, en discutant avec le patient et les proches". Pour confirmer la première étape et dissiper les doutes il va utiliser "l’électroencéphalogramme (EEG), qui va montrer les pics et étincelles détectés si le patient est atteint d’épilepsie". Le professeur indique également "qu’il peut y avoir des erreurs médicales, comme par exemple après un malaise vagal, la personne est dite épileptique alors qu’elle ne l’est pas forcément". Delphine Dannecker rétorque "qu’il est important d'avoir un diagnostic le plus tôt possible afin de minimiser les dégâts dans le cerveau". En effet, les crises à répétition peuvent endommager cet organe vital.
Vincent Navarro insiste sur "la nécessité de réaliser une vraie enquête policière pour déterminer les causes de la maladie". Il révèle que les crises d’épilepsie peuvent survenir "à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Les cellules endommagées vont envoyer des informations aux autres cellules, ce qui va générer un court-circuit, donc une crise. Une tumeur cérébrale bénigne peut aussi appuyer sur les neurones, une maladie auto-immune peut enflammer une partie du cortex cérébral… Des causes génétiques peuvent aussi en être à l’origine, c’est rare mais un gène peut avoir muté. Enfin, il y a plusieurs autres maladies rares qui peuvent provoquer une crise, comme une anomalie du développement du cerveau, par exemple". Marie-Agnès, présidente de l'association Accueil Epilepsies Grand Est, rappelle que "lorsque l’on a déjà fait une crise par le passé, le stress intense ou le manque de sommeil peut en provoquer une".
Il faut parfois plusieurs mois ou années avant qu’un diagnostic correct soit fait.
Même si la maladie se soigne, le taux de mortalité des personnes épileptiques est deux à trois fois supérieur à la population générale. Vincent Navarro atteste "que l'on peut mourir de l’épilepsie de façon directe et indirecte". La mort peut être causée par la maladie même, "lorsque le patient enchaîne les crises, surtout quand il n’a pas de traitement adapté", mentionne le professeur. "Une grosse crise peut aussi survenir pendant le sommeil et provoquer un arrêt respiratoire."
Mais Vincent Navarro signale aussi que "la mort peut survenir lors d’un accident. Si un malade tombe lors d’une crise, il y a un risque de traumatisme crânien. Les médicaments jouent aussi sur les troubles de l'humeur et peuvent provoquer une dépression, des tentatives de suicide sont donc également possibles". Le but n’est cependant pas de faire peur, mais c’est la réalité à laquelle sont confrontés les malades. "Il faut dédramatiser tout en expliquant les risques", alerte Emmanuelle Roubertie, directrice générale de la Fondation Française pour la Recherche sur l’Épilepsie.
Comment traiter l’épilepsie ?
Le monde de l’épilepsie est divisé en deux : les patients qui ont accès à un traitement représentent 70 % des malades, tandis que les 30 % restants ne trouvent aucun médicament qui leur permet de ne plus faire de crise. Dans le premier cas, "c’est un grand parcours pour trouver le bon médicament avec le neurologue", confie Delphine Dannecker, se remémorant le long chemin parcouru face à l’épilepsie de sa fille. Vincent Navarro certifie que "la recherche avance, on a maintenant un vrai arsenal thérapeutique, mais on aimerait en avoir plus". Les médicaments pour traiter cette maladie agissent en "bloquant l’activité anormale du cerveau, mais laissent le reste", explique le neurologue. "Ils évitent la transmission d’informations excessives dans les neurones et réduisent considérablement le nombre de crises, certains n’en n’ont plus", poursuit-il. "Prendre ses médicaments, c’est vital", insiste Delphine Dannecker, qui se souvient avoir accompagné une mère dont le fils est décédé car il ne voulait pas prendre ses médicaments.
La présidente de l'association Épilepsie-France expose également les effets secondaires de ces médicaments, souvent lourds : "le fait d’être au ralenti, d’avoir envie de dormir, d’avoir des excès de colère ou encore de développer une dépression." Elle indique également que "30 % des personnes épileptiques sont pharmaco résistantes, c’est-à-dire qu’aucun médicament n’améliore leur état, ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, une crise peut survenir à tout moment contrairement à ceux sous traitement". Delphine Dannecker maintient "qu’une vie réglée avec une bonne hygiène de vie comme faire du sport ou de la méditation, contribue à apaiser le cerveau et à réduire les crises".
Les patients qui ont accès à un traitement représentent 70 % des malades, tandis que les 30 % restants ne trouvent aucun médicament.
Les personnes épileptiques peuvent guérir de cette maladie. Le professeur Vincent Navarro démontre que des "formes d’épilepsie bénignes existent, lorsque par exemple un enfant faisait des absences à l’école. Dans ce cas, la maladie peut disparaître spontanément avec la maturité cérébrale, en grandissant". Dans d’autres cas, la chirurgie est aussi une solution pour guérir. "Lorsque l’épilepsie se trouve sur une séquelle cérébrale active, on peut opérer et c’est miraculeux quand ça marche", se réjouit le professeur. Si ni l’un, ni l’autre n’est possible, le patient devra apprendre à vivre avec sa maladie, ainsi que ses proches.
Comment réagir lors d’une crise ?
"Comment protéger l’autre tout en l’aidant ?", se questionne Emmanuelle Roubertie. Le plus important est de démolir les multiples préjugés sur cette maladie. Lorsqu’une personne est en crise, il ne faut rien mettre dans sa bouche, alors que l’inverse est très souvent entendu. Delphine Dannecker rappelle "qu'il faut mettre la personne en Position latérale de sécurité (PLS), pour éviter qu’elle ne se blesse et qu’elle puisse respirer en cas de vomissements."
Comment protéger l’autre tout en l’aidant ?
La présidente d’Épilepsie-France recommande de "rester près de la personne et de regarder sa montre. Il faut appeler les secours au bout de trois ou quatre minutes de crise". Vincent Navarro confirme qu’il faut "éviter que la crise ne perdure si elle est violente et accompagnée de convulsions. En effet, si le malade réagit de cette manière, il est en apnée. S'il dépasse les quatre à cinq minutes, il y a un risque d’arrêt respiratoire, donc il faudra appeler les pompiers".
Une autre conséquence : le pronostic social engagé
"L’épilepsie a une répercussion dans tous les aspects de la vie", évoque Emmanuelle Roubertie. C’est pour cela que connaître la maladie est indispensable, autant pour le malade que pour l’aidant. Delphine Dannecker parle de "pronostic social engagé" lorsque l’on a un enfant épileptique. "Le but, c’est de laisser un large éventail de possibilités pour que la maladie ne soit pas invalidante dans son côté social", précise la présidente d’Épilepsie-France.
"En tant que parents, on va se faire beaucoup de soucis sur sa santé et sur son intégration scolaire et on va quelquefois laisser de côté les activités, les loisirs, tout ce qui contribue à faire d’eux des citoyens" , explique-t-elle. "Plus on met de côté ces enfants, moins ils auront la chance d’être des adultes épanouis."
Comment accompagner les malades et leurs proches ?
Ne pas isoler l’enfant est très important, de même que l’adulte. L’emploi, la mobilité ou la grossesse par exemple peuvent être affectés par la maladie. "Il faut que les personnes atteintes d’épilepsie connaissent les conséquences de la maladie sur leur vie quotidienne et en informent les gens", affirme Marie-Agnès en tant que présidente de l'association Accueil Epilepsies Grand Est.
Plus on met de côté ces enfants, moins ils auront la chance d’être des adultes épanouis.
"La demande d’aide vient des aidants", révèle Emmanuelle Roubertie. Au-delà de son nom, la Fondation Française pour la Recherche sur l’Épilepsie informe et accompagne les malades et les familles de quatre façons différentes. "C’est une action à 360 degrés", souligne sa présidente. L'association finance des projets pour améliorer la recherche mais informe également les familles sur les conséquences de cette maladie. L'écoute est aussi la clé pour ne pas se sentir seul. C'est pour cela que l'association a mis en place un groupe privé Facebook, à l’image des groupes de paroles pour échanger sur la maladie. Les bénévoles interviennent aussi dans les entreprises pour exprimer les droits des malades. Enfin, mettre les familles en lien avec des médecins est important "pour que les gens ne soient pas perdus", reconnaît Emmanuelle Roubertie. Marie-Agnès, quant à elle, milite pour un accompagnement psychologique des aidants et de leur famille face à une maladie qui demande beaucoup d’énergie.
Malgré de grandes avancées, l’épilepsie est toujours une maladie taboue. La Fondation Française pour la Recherche sur l’Épilepsie fait face depuis 30 ans à un manque de porte-paroles connus. En effet, Emmanuelle Roubertie avance que "plusieurs célébrités sont touchées par la maladie mais lorsqu'on leur demande de témoigner en public, elles ne veulent pas, affirmant que ça va gâcher leur image. C’est vraiment comme le sida dans les années 1980/1990 !"
La demande d’aide vient des aidants.
Il faut donc sensibiliser les gens à la maladie. Pour pouvoir mieux intégrer les malades et casser les préjugés. Emmanuelle Roubertie témoigne d’un "réel changement". Elle a déjà participé à des campagnes d’informations dans le métro, des soirées caritatives et des colloques. Elle déplore ne "pas pouvoir faire campagne à la télévision comme le téléthon par manque de moyens. Il faudrait que l’épilepsie devienne une grande cause nationale", espère-t-elle. Elle soutient que "de plus en plus de médias s’emparent du sujet. Ça va mieux mais il y a encore beaucoup à faire pour que les regards changent sur l'épilepsie !".


Cette émission interactive de deux heures présentée par Melchior Gormand est une invitation à la réflexion et à l’action. Une heure pour réfléchir et prendre du recul sur l’actualité avec des invités interviewés par Véronique Alzieu, Pauline de Torsiac, Stéphanie Gallet, Madeleine Vatel et Vincent Belotti. Une heure pour agir, avec les témoignages d’acteurs de terrain pour se mettre en mouvement et s’engager dans la construction du monde de demain.
Intervenez en direct au 04 72 38 20 23, dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis ou écrivez à direct@rcf.fr