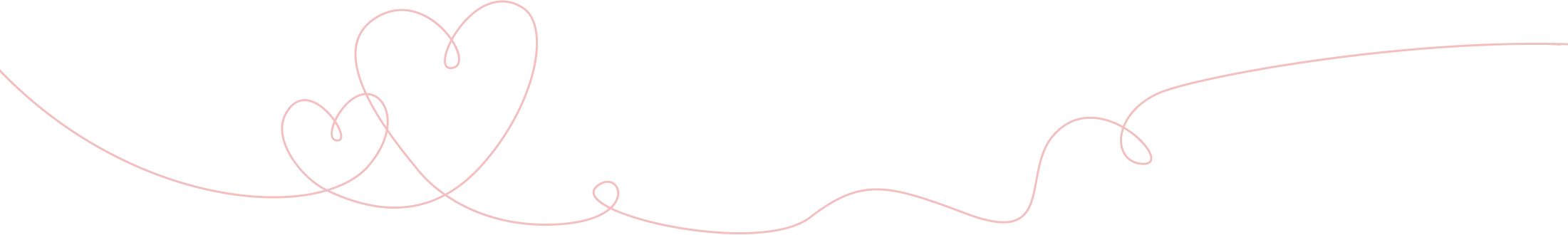L'Évangile selon Saint Matthieu (1964) de Pier Paolo Pasolini : quand le Grand Soir rencontre la Vie Éternelle
Parmi les œuvres cinématographiques les plus importantes du XXe siècle, L'Évangile selon Saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini se dresse dans l'esprit des cinéphiles telle une Cathédrale érigée dans un désert. Cet acte hautement anarchiste, qui dépasse aisément les codes du cinéma, se voit amplifié dans sa subversion par l'application, à la ligne près, d'une fidélité rigoureuse à l’orthodoxie des Évangiles. Une rigueur, au passage, que seule l'âme inconoclaste et mystique d'un authentique auteur pouvait assumer et réussir à mettre en œuvre formellement.
Ainsi, après visionnage, il est évident que nous ne sommes pas en présence d'un simple film : c'est, en vrai, un bel affront lancé au confort spirituel doublé d'un miroir tendu vers l'immobilisme mortifère. Une litanie ardente, de révolte et de Grâce, qui parvient à mettre le feu dans les intérieurs mentaux trop bien rangés - tout en retranscrivant, de la plus belle des manières, le Message d'Amour révolutionnaire du Christ.
 Enrique Irazoqui, dans "L'Évangile selon Saint Matthieu" (1964). Photo Alamy. Photo 12.
Enrique Irazoqui, dans "L'Évangile selon Saint Matthieu" (1964). Photo Alamy. Photo 12.
Le bellatores du cinéma
En adversaire impitoyable des truismes, Pasolini défie, dans L'Évangile selon St Matthieu, toute tentative de classification. Le génie de ce film réside, en priorité, dans la personnalité de son réalisateur, insaisissable au niveau politique à l'instar, entre autres, d'un Marcel Aymé en littérature. En qualité d'esthète et d'intellectuel véritable, le cinéaste se permet ainsi de chevaucher les frontières mouvantes (voire inutiles) de l'idéologie.
Poète, peintre, essayiste, cinéaste... c'est tandis qu'il navigue dans un clair-obscur moral que l'artiste Pasolini s'épanouit le mieux, refusant courageusement les manichéismes tentateurs. Il se détourne sans concessions de ces chemins faciles qui mènent trop rapidement à de trop nombreuses impasses de la pensées. Embrassant les contradictions comme d'autres embrassent la Foi, il convoque alors, à lui seul, un concile d'idées opposées mêlant savamment la chair et l’esprit, la beauté et la douleur ainsi que l’indignation et l’adoration.
Sous cette égide, adapter à la lettre près le texte évangélique – cette tentative qui aurait pu paraître sèche, érudite ou désincarnée – devient devant sa caméra un acte de déflagration théologique. Que cet hommage radical à l'Évangile provienne d’un homosexuel matérialiste et provocateur, autrefois condamné à la prison en Italie pour blasphème, confère indéniablement à l'œuvre une dimension Christique. Par la même, le sujet de son film se voit mis en abime réussissant, en outre, la synthèse parfaite du fond et de la forme.
Dès lors, Pasolini, tel un mutin perspicace, transforme la rigidité du dogme chrétien en moteur de la rébellion, oscillant entre le Sacré et le profane avec une aisance qui fait vaciller le spectateur.
Mais au-delà de son propre paradoxe, Pasolini s’affirme ici comme un passeur, non de dogmes figés, mais de Vérités incandescentes. Il capte l’écho d’un temps où la Foi n’était pas encore diluée par les discours formatés, un moment où les Évangiles résonnaient comme une parole vivante, à la fois proche et imprécatrice.
Lorsque Jésus crie
Vous l'aurez compris: le Jésus de L'Évangile selon Saint Matthieu n'est ni l'agneau immaculé, ni l’idole aseptisée des missels dorés. Il est plutôt présenté comme un prophète nerveux et incandescent, une figure charismatique qui convoque Proudhon au cœur des campagnes italiennes menacées par le rouleau compresseur du Marché naissant.
De la sorte, le Christ de Pasolini ressemble au paysan insurgé, à un révolutionnaire à la fois pleinement incarné et totalement mystique. Sa transcendance n'est pas qu'une abstraction céleste, mais aussi une force immanente, enracinée dans la glaise et la sueur des terres de Judée (et donc, hors de la diegèse du film, d'Italie). Pasolini, à dessein, fait de son Jésus une figure Politique, un homme du Peuple autant qu’un messager de l’Absolu. Un emblème de résistance face à l’engloutissement des traditions par les logiques libérales. Il n’est pas qu'un sage immobile prêchant l’amour universel, mais un homme frondeur, concerné, déterminé et colérique, qui s'échine de bouleverser l’ordre établi par sa simple présence. Son visage, maigre et sanguin, traduit l’urgence, presque l’impatience d’un message à transmettre avant qu’il ne soit trop tard.
Et cette itération, profondément humaine, fait de ce Jésus un miroir : à la fois un reflet des luttes sociales de l’époque et une préfiguration de celles à venir. Car, à travers lui, Pasolini interroge non seulement la Foi, mais aussi l’engagement, la fidélité à soi-même et à ses idéaux dans un monde bouleversé qui entame funestement, à nouveau, une pente inhumaine.
De ce fait, L'Évangile selon Saint Matthieu est bien plus qu’une œuvre religieuse. C’est une déclaration d’amour rageur à un monde en train de disparaître. Car c'est dans ce Christ rustique et séditieux que Pasolini projette sa propre révolte contre la standardisation des vies et des âmes. Paradoxalement, c’est dans cette fidélité à une foi qu’il ne partageait pas qu'il va trouver les ressources pour combattre son époque. Et pourtant, à aucun moment du film l’idéologie ne noie l’Art. La politique reste tout naturellement une toile de fond, un bruissement sous-jacent. Ce qui prime sur tout, c’est la beauté fragile du geste cinématographique, cette force brute d’une œuvre où chaque plan semble capturer l’éclat d’une Vérité insaisissable.
Une esthétique de l’intranquillité
Les paysages arides de la Basilicate, les visages burinés par le soleil, les silences entrecoupés de chants archaïques... tout dans L'Évangile selon Saint Matthieu appelle à la Miséricorde sans jamais sombrer dans le misérabilisme ou dans le folklore. Ici, la piété est rude, rugueuse, tellement humaine. L’iconographie se fait minimaliste, presque ascétique : des plaines rocailleuses, des bâtiments austères, des foules silencieuses. Rien n’est là pour éblouir ; tout est là pour exister. Ce film est un artéfact baroque dans son dépouillement, un morceau déchirant de Calypso visuel. Ainsi, la bande-son, disparate et cacophonique, participe de cette esthétique délicatement vibrante. Entre le chant grégorien, le folk américain et la musique sacrée de Bach, Pasolini compose un collage sonore où chaque note semble simultanément en porte-à-faux et miraculeusement à sa place. Et c'est dans ce charivari contrôlé que se reflètent les fructueuses tensions du film : entre l’éternité du Verbe et la matérialité brute de l’image.
Aussi, les choix stylistiques de Pasolini transcendent la simple narration. Chaque plan, chaque visage, chaque pierre porte une densité sans pareille. L’esthétique devient quasiment une épreuve, une croix que le spectateur doit porter avec le Christ. C’est là l’une des grandes réussites de l’œuvre : transformer le visionnage en expérience mystique, même (et surtout) pour les non-croyants.
Somme toute, si L’Évangile selon Saint Matthieu résonne encore aujourd’hui, c’est qu’il transcende le temps et les modes - Qu'il interpelle une humanité, au fond, toujours en cheminement; à la croisée des chemins entre un matérialisme effréné et le besoin atavique de transcendance. Le film fonctionne comme un rappel brutal qui hurle que le Sacré ne peut être domestiqué. Finalement, en pointant dans son film la rudesse et la puissance des Évangiles, Pasolini rend aux textes anciens leur vigueur originelle, loin des clichés mièvres ou des trop nombreuses récupérations institutionnelles qui s'évertuent à stériliser le Message. À sa manière, il renouvelle une perception ardente de la Foi – non pas comme une adhésion aveugle, mais comme une quête d'authenticité...
Une résistance ultime à l’effacement.
Découvrez d'autres décryptages cinématographiques dans L'Œil de Dieu, une émission proposée par Laurent Verpoorten et Jean-Marc Reichart.


Depuis ses origines, le cinéma n'a cessé d'illustrer, d'enseigner ou de mettre en question la foi chrétienne.
Qu'il s'agisse de Dieu lui-même, de Jésus, des saints et des saintes ou des valeurs catholiques, l'enjeu demeure identique : amener au visible ce qui par définition est invisible.
Dans L'oeil de Dieu, Laurent Verpoorten et Jean-Marc Reichart vous proposent de redécouvrir les grandes œuvres cinématographiques religieuses anciennes et contemporaines afin d'en goûter la profondeur.