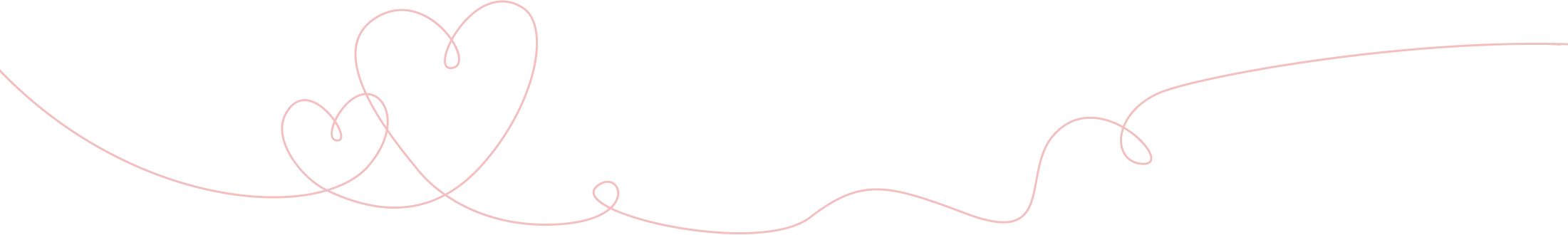L’inter-relation entre les Evangiles synoptiques
Toutes les deux semaines, Sophie Robert-Hayek, chercheuse en théologie à l'Université de Lorraine, rejoint RCF Jerico Moselle dans l'émission Entre midi, entre Lorrains.
Ce lundi 10 mars, elle nous raconte l’un des plus grands mystères de la littérature ancienne : l’inter-relation entre les Evangiles synoptiques.
Ce sujet vous intéresse? Retrouvez cette chronique juste ici.
 © Canva
© Canva
Il s’agit d’un des plus grands mystères du texte biblique, et qui nous résiste toujours.
Déjà, petit rappel, les Evangiles synoptiques sont les Evangiles de Matthieu, Marc et Luc. On les désigne de cette manière, par l’adjectif synoptique, du grec sun et optikos, qui signifie "voir ensemble", car il est possible de les mettre en colonne tant ils relatent des évènements très proches.
Vous avez des exemples de passage qui peuvent être mis en parallèle ?
Oui, il y en a plein ! En science biblique, on ne parle d’ailleurs pas de ”passage”, mais de ”péricope” pour se référer aux petites unités narratives qui composent les Evangiles synoptiques. Si vous les lisez avec attention, ceux-ci sont composes de pleins de ces petites unités, qui ont un incipit, avec souvent un élément déclencheur, comme par exemple une controverse avec les Pharisiens ou bien un malade qui est impossible de guérir, puis une action qui fait que Jésus résout cette tension narrative, avec souvent pour conclusion que son entourage est émerveillé par ses actions. C’est ce qui fait que les Evangiles synoptiques se prêtent si bien à la liturgie, car ils peuvent très simplement se découper en petites histoires autonomes.
Des exemples de péricopes parallèles présentes dans Matthieu, Marc et Luc, et on utilise le terme d’appartenance à la Triple Tradition, sont par exemple celles de la guérison de la belle mère de Pierre, celle de la transfiguration, ou bien celle de la guérison de la femme hémoroïsse... On considère que 41% de l’Evangile de Luc, 46% de l’Evangile de Matthieu et 76% de l'Evangile de Marc font partis de la Triple Tradition.
Est-ce que chacune des péricopes trouve son parallèle dans un des autres évangiles ?
Non, il y a ce qu’on appelle la tradition propre qui est tout ce qui concerne les péricopes qui ne sont présentes que dans un Evangile.
Pour l’Evangile de Luc, cela concerne toutes les longues paraboles qui marquent l’imagination, comme celle du Bon Samaritain, du Fils Prodigue ou bien celle de l’homme riche et de Lazare.
Pour Matthieu, il s’agit par exemple des paraboles apocalyptiques, qui vont faire allusion a l’avènement final du Royaume de Dieu et au jugement dernier. Vous avez par exemple la parabole des Vierges Folles et des Vierges Sages, des ouvriers de la dernière heure, ou bien celle des chèvres et des brebis qui relatent la séparation entre ceux promis à la vie éternelle et ceux promis au feu éternel.
Et pour l’Evangile de Marc ?
Pour l’Evangile de Marc, c’est assez particulier, car celui-ci présente très peu de tradition qui lui est propre, on peut les compter sur les doigts d’une main : vous avez une parabole originale, celle de la graine en terre, une guérison à Décapolis, et une scène très intrigante, celle de l’homme nu qui s’échappe lors de l’arrestation de Jésus.
Y a t’il des péricopes qui seraient présentes dans seulement deux Evangiles ?
Oui, et tout particulièrement entre les Evangiles de Luc et de Matthieu, et c’est eux qui rendent l’explication de l’inter-relation entre les Evangiles particulièrement compliqué : vous avez à peu près une vingtaine de pourcent des péricopes de Luc et de Matthieu, principalement des paroles de Jésus, qui sont présentes dans ces deux Evangiles, mais absent de Marc. Il faut donc que la recherche puisse expliquer cette grosse divergence entre Marc et les deux autres Evangiles.
Quels sont les modèles qui peuvent expliquer cette indépendance ?
Il y en a un certain nombre, et ce depuis l’Antiquité. La croyance antique, qui va perdurer jusqu’au XVIIIe siècle, se base sur les témoignages de deux Pères de l’Eglise, Papias et Irénée, qui affirment que Matthieu aurait été écrit en premier, en araméen, puis que Marc aurait composé un résumé des dires de Pierre à Rome, et que Luc aurait repris à la fois l’Evangile de Marc et l’Evangile de Matthieu pour en faire la version la plus complète possible.
C’est cet ordre qui est repris dans nos Bibles, ou nous avons d’abord Matthieu, puis Marc, et enfin Luc. Une petite anecdote est que cet ordre n’a été standardisé que bien après la fin de l’Antiquité, car nous avons des Bibles qui nous sont revenues, et notamment le Codex de Beze, dans ce que nous appelons l’ordre Occidental : d’abord Matthieu, puis Jean, Luc et enfin Marc.
Quelles sont les théories actuelles ?
La croyance en cet ordre de rédaction est profondément remis en cause par la naissance de l’approche critique vis a vis des croyances traditionnelles sur le texte biblique au 18ème
siècle.
Vous avez alors deux grandes théories de rédaction qui s’affrontent : celle des modèles généalogiques, qui considèrent que les rédacteurs des Evangiles avaient accès aux autres Evangiles, et les modèles des sources, qui considèrent que les Evangiles avaient juste accès à des sources en commun. Parmi les modèles les plus commun, vous avez le modèle de Farrer-Goodacre qui considère que Marc est écrit le premier, puis Matthieu en se basant sur Marc, et enfin, Luc qui aurait eu en main Matthieu.
A l’oppose, vous avez l’hypothèse des deux sources, majoritairement soutenue par la recherche et introduit au début du XXème siècle par Streeter, qui considère que Luc et Matthieu sont des œuvres indépendantes qui auraient eu à leur disposition une source de paroles de Jésus et l’Evangile de Marc.
Et l’Evangile de Jean dans tout ça ?
L’Evangile de Jean épaissit encore le mystère de la rédaction des Evangiles. Finalement, le problème est binaire : soient les rédacteurs de l’Evangile de Jean ignoraient l’existence des Evangiles synoptiques, soient ils les connaissaient, et y avait eu, sinon partiellement, accès.
Si jamais vous faîtes la première hypothèse d’ignorance des Evangiles synoptiques, il faut pouvoir défendre le fait que les rédacteurs de l’Evangile de Jean ait inventé en parallèle de manière indépendante le genre Evangile, c’est à dire le genre littéraire qui présenterait la vie de Jésus, de son baptême à sa résurrection et crucifixion. Il faut aussi pouvoir justifier pourquoi est-ce que cette communauté n’aurait pas eu accès à ces écrits, si nous datons les Evangiles synoptiques autour de l’an 70, avant de les diffuser un peu partout dans l’Empire Romain, et l’Evangile de Jean autour de l’an 100 : cela voudrait dire que pendant 30 ans, une communauté chrétienne aurait pu ne pas avoir à cette littérature fondatrice de ce qui deviendra la religion chrétienne.
Par contre, si jamais vous faîtes l’hypothèse d’une dépendance entre l’Evangile de Jean et les Evangiles synoptiques, il vous faut expliquer pourquoi une telle différence entre eux : les thèmes abordés sont extrêmement différent, la théologie développée par les auteurs ne se recoupe que très peu, et très peu des évènements relatés peuvent se mettre en parallèle.
Le mystère de l’inter-relation entre les Evangiles demeure ainsi très opaque.


"Entre midi", ce moment de la journée qui n'existe qu'en Lorraine : les équipes locales de RCF vous invitent chaque jour de la semaine, en direct, pour prendre le temps d'analyser et comprendre l'actualité de notre région.