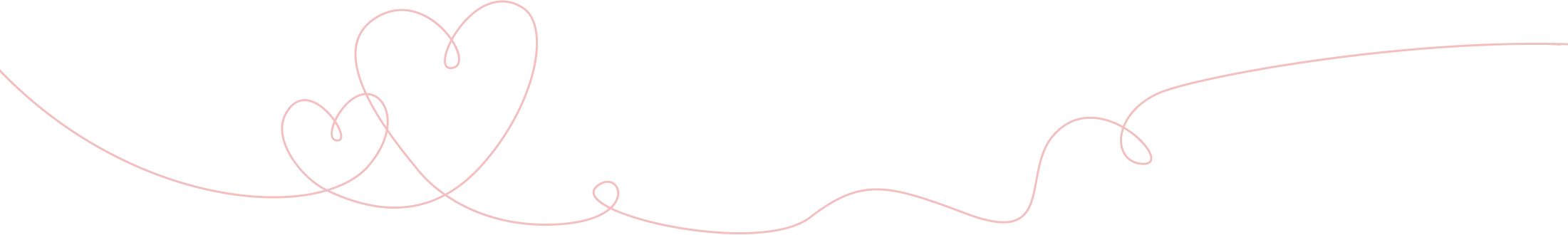Le mercredi des cendres
Ce mercredi 5 mars 2025 marque le Mercredi des Cendres. À cette occasion, Victor Benz, référent en art sacré au Diocèse de Metz, nous explique la signification de cette journée ainsi que son origine.
Ce sujet vous intéresse ? Retrouvez cette chronique juste ici.
 © Canva
© Canva
Qu’est-ce que le mercredi des cendres ?
L’entrée dans le carême se manifeste par un rite particulier. L’imposition de cendre sur les fronts avec la formule rituelle « souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Une amie commentait à sa manière : « le reste de l’année on passe l’aspirateur ».
Plus sérieusement, la formule alternative, moins factuelle, plus poétique, tournée vers l’espérance nous fait entendre « convertissez-vous, croyez à la Bonne Nouvelle! ».
La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, précisément par le chemin de l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre pauvreté. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les cendres.
Cette conversion, c’est-à-dire littéralement tourner son cœur, son être, son agir vers le bien, s’ajuster à la volonté de Dieu.
Quelle est l’origine de ce rite ?
On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être.
On peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence. L’homme a perçu il y a longtemps déjà qu’en un instant tout peut redevenir cendre.
Il existe plusieurs attitudes : se lamenter et ne jamais rien reconstruire, s’épuiser à tout rebâtir de ses mains ; ces deux attitudes conduisent à la mort de l’esprit ou à la mort du corps.
En nous tournant vers Dieu dans un abandon confiant : il s’agit de rendre grâce pour ce qui est reçu, de s’en remettre à la Providence, en somme d’oser l’espérance.
En cette année de jubilé, cela doit résonner d’une manière particulière en nous.
Que dit la Bible ?
Il ne s’agit pas de faire une « tête de carême » comme le dit l’expression populaire.
L’évangéliste Mathieu au Chapitre 6 nous donne la recommandation du Christ : « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. »
Il est donc question de jeuner ?
La pratique du jeûne a évolué tout au long des siècles. Il est aujourd’hui prescrit deux jours par an pendant le Carême : le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. Des traces de cette pratique existaient à la fin du premier siècle.
Pâques était alors préparé par un jeûne de deux jours, les Vendredi et Samedi saints. La pratique du Carême tel qu’on le connaît aujourd’hui, remonte au IVe siècle.
Dans les premiers siècles, jeûner signifiait ne pas manger et l’abstinence, de s’abstenir de consommer de la viande et du jus de viande. Les œufs et les laitages, ainsi que les condiments issus de graisses animales sont cependant autorisés. Plusieurs moments de jeûne ont lieu dans l’année : celui du Carême, ceux des vigiles des fêtes (Noël, Épiphanie, Ascension, Pentecôte, Assomption et Toussaint) et ceux des Quatre-Temps.
Pendant plus de dix siècles, les règles du jeûne et de l’abstinence restent inchangées, obligatoires pour tous les chrétiens, sauf pour les malades et les infirmes. Mais le jeûne pris de manière isolé n’est qu’un régime, il se comprend en lien avec la prière et l’aumône.
« Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est
présent dans le secret. »
« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te donne ta main droite, afin
que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret. »
40 jours pour se préparer à Pâques
Le chiffre symbolique de 40 est présent dans la bible dès qu’il s’agit d’un temps d’attente et de conversion. Il fait référence aux quarante jours de Noé dans l’arche, aux quarante ans de Moïse dans le désert, aux quarante jours de jeûne du Christ au désert… Quadragesima en latin est devenu caresme en vieux français, et perdant son « s », gagnant un accent circonflexe, devient le carême.
Si l’on compte bien, entre le mercredi des cendres et le jour de Pâques, nous arrivons à 50 jours, autant que de Pâques à la Pentecôte : 40 jours + 5 dimanches de carême + dimanche des rameaux et de la Passion + Triduum pascal, nous arrivons à 49 jours et le lendemain, c’est Pâques.
D’un point de vue liturgique, une fête dans l’église commence par la célébration des premières vêpres la veille au soir. Nous avons conservé en partie l’usage juif qui fait commencer la journée par la tombée de la nuit. Il ressuscita le troisième jour… on sait que Jésus mourut sur la croix la veille du sabbat, à la fin de la journée de vendredi, puis le sabbat et enfin le troisième jour qui deviendra chez les chrétiens, le jour du Seigneur : dies domini qui donnera le nom du premier jour de la semaine : dimanche et par extension le prénom Dominique et tous ses dérivés.
Ainsi le carême est un chemin
Les dimanches du carême présentent une progression dans le choix des lectures.
Celles de l’année A sont particulièrement adaptées pour un cheminement de type catéchuménal.
Nous redécouvrons depuis quelques décennies la demande de baptême d’adultes alors que depuis des siècles on était baptisé quelques jours après notre naissance.
Les années B et C permettent d’entendre d’autres récits de guérisons et de conversions. Comme le dit le concile Vatican II, c’est ouvrir aux fidèles le trésor des écritures. L’accent est mis davantage sur la conversion que la méditation de la souffrance du Christ en croix. Elle n’est pas occultée mais remise à une place juste pour que notre piété ne devienne pas doloriste.
La méditation du chemin de croix nous met en perspective la résurrection et c’est dans cette espérance que la souffrance du Christ peut être assumée, sinon, c’est simplement une longue lamentation qui nous laisse assis sur la pierre du tombeau au lieu de nous élever par cette main tendue par celui qui a vaincu la mort.
Bon carême, plein d’espérance, à tous.


"Entre midi", ce moment de la journée qui n'existe qu'en Lorraine : les équipes locales de RCF vous invitent chaque jour de la semaine, en direct, pour prendre le temps d'analyser et comprendre l'actualité de notre région.
RCF vit grâce à vos dons
RCF est une radio associative et professionnelle.
Pour préserver la qualité de ses programmes et son indépendance, RCF compte sur la mobilisation de tous ses auditeurs. Vous aussi participez à son financement !