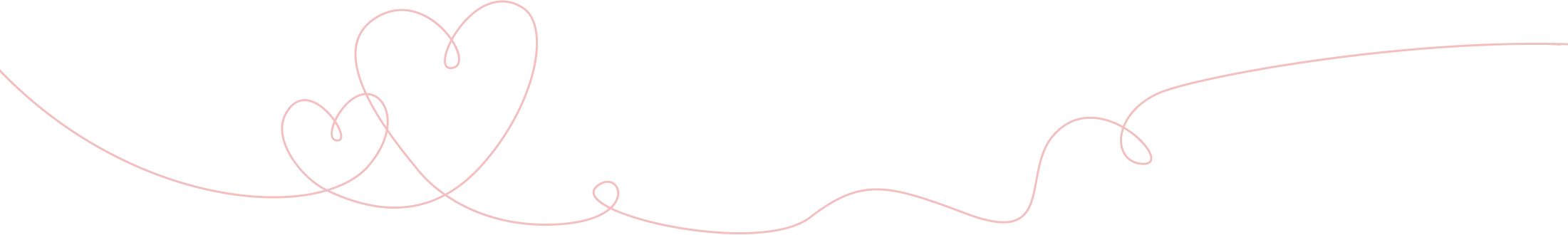Depuis quand les séminaires existent-ils ?
 Version 1920x1080 1719308133
Version 1920x1080 1719308133"Un séminaire est une école, et pas seulement une école de piété, mais aussi un "studium", c'est-à-dire un ensemble de cours, de leçons, de manuels, d'auteurs, d'examen." définit Jean de la Viguerie, historien spécialisé de l'Eglise catholique au siècle des Lumières. Si aujourd'hui, il est obligatoire pour les futurs prêtres d'étudier pendant sept ans la théologie, la philosophie etc...cela n'a pas toujours été le cas. Ce n'est même que récemment que les prêtres sont formés dans un séminaire.
Histoire de la création des séminaires en France
Le Concile de Trente (1545-1563) a suscité de nombreuses réformes pour la religion catholique et sa pratique. Parmi elles, la création de lieux pour l'éducation des clercs. "Le séminaire, tel qu'il le conçoit, est un établissement unique destiné à former les clercs depuis l'âge de treize ans jusqu'à la prêtrise. Il prend leur éducation à la grammaire et la conduit jusqu'à la théologie inclusivement" édicte l'Eglise de France à la suite du Concile.
C'est le cardinal de Lorraine, archevêque de Reims, qui fonde le premier séminaire de France le 20 mars 1564. Le séminaire était composé "d'un supérieur (magistère), un docteur en théologie, assisté de trois prêtres dont l'un serait sous-directeur, l'autre économe et le troisième surveillant. Les élèves devaient être de Reims, du diocèse, être âgés de quatorze ans ou de treize au moins, présenter une santé suffisante pour supporter le travail des études et le régime du séminaire, s'engager par serment à obéir à l'archevêque et à ses représentants et affirmer sous serment que leur intention présente était bien de se destiner à l'état ecclésiastique". Les décrets de ce concile rencontre un accueil défavorable auprès de la couronne de France, mais l'insistance du clergé l'obligea à en autoriser certains. Celui sur les séminaires en fait partie. Le roi Henri III, dans l'ordonnance de Blois a inscrit un cadre pour leur établissement dans le royaume. "Aux évêques de dresser et instituer ( des collèges et séminaires) en leurs diocèses et aviser de la forme qui semblera le plus propre selon la nécessité et conditions des lieux et pourvoir à la fondation et dotation par union de bénéfices, assignations de pensions ou autrement, ainsi qu'ils verront être à faire." A cette période, les séminaires ressemblaient plus à des collèges pour des jeunes en situation de pauvreté ainsi qu'un vivier pour les évêques quand il manquait un prêtre dans une paroisse.
Le premier séminaire de "jeunes hommes"
C'est en 1583 que Charles de Gélas de Léberon, évêque de Valence destine son séminaire non à des enfants mais à des "jeunes hommes". C'est une première dans l'histoire des séminaires. Saint Vincent de Paul en 1642 était de cet avis, "j'approuve son dessein en toute son étendue...si ce n'est à l'égard des enfants qu'il veut qui y soient élevés, car jusqu'à présent, je n'y ai pas ouï dire que par un de cette sorte ait réussi au bien de l'Eglise." écrit-il à un missionnaire. Les évêques de son temps étaient d'accord avec lui et désiraient des séminaires de "jeunes hommes". C'est ainsi que le terme de "séminaires d'ordinands" ou "grands séminaires" voit le jour. Ils étaient exclusivement réservés aux ecclésiastiques "déjà en état de recevoir les ordres et désireux de s'y préparer". Deux limites des grands séminaires ont vu le jour. La première est la formation des clercs qui ne commence qu'à leur entrée dans les Ordres. La deuxième, ces clercs devaient être en capacité de payer intégralement leur pension. Ainsi les pauvres ne pouvaient pas avoir accès à la prêtrise. De nombreux évêques comme Nicolas de Sevin, évêque de Cahors ce sont opposés à ces principes et décidèrent de fonder les "petits séminaires". Avant d'ouvrir des maisons, les évêques, en particulier ceux des campagnes demandent aux curés "de prendre un soin particulier des jeunes clercs ou même des enfants qui aspirent à l'état ecclésiastique; ils doivent veiller sur leur conduite, étudier leurs dispositions, au besoin de les préparer à entrer au séminaire." Ces jeunes aspirants, grâce à l'aide du clergé, assistent à des conférences de formation religieuse ou d'enseignements littéraire. C'est à Angers que le premier "petit séminaire" voit le jour sous l'impulsion de l'abbé Yvelin de Buisson.
La formation et le temps passé au séminaire évoluent dans le temps. Les cours deviennent plus denses et plus variés ; le temps au séminaire plus long. En 1658, il est requis de n'effectuer qu'un mois de retraite avant chacune des grandes ordinations (sous-diaconat, diaconat, prêtrise). À la fin du XVIIIe siècle, cette période de retraite atteint un total de quinze mois.
Devenir prêtre au XXIème siècle
Prêtre diocésain, dans une communauté, une congrégation… Aujourd'hui, il existe différentes manières de vivre sa vie de prêtre et la formation en est la base. Un jeune qui a le désir de s'engager au sein de son diocèse, doit suivre une année propédeutique et son cursus dans un séminaire diocésain. L'année propédeutique est la nouveauté du Concile Vatican II. "Pour fonder de manière plus solide la formation spirituelle et pour que les séminaristes puissent ratifier leur vocation par une option mûrement délibérée, il appartiendra aux évêques d’instituer, pour une durée convenable, un entraînement spirituel plus poussé" (Concile Vatican II, Optatam Totius, 1965, au n°62). Pour ceux qui désirent vivre leur sacerdoce dans une communauté, ils doivent entrer dans la communauté ou la congrégation et suivre la formation proposée. La communauté Saint Martin, par exemple, propose aussi une année de propédeutique avant de commencer sa formation.
Le cursus d'un séminariste se découpe en trois temps. La première année est consacrée au discernement c'est ce que l'Eglise appelle la "propédeutique". Le premier cycle englobe la deuxième et la troisième année. Durant deux ans, les séminaristes vont suivre un cursus académique et ecclésiastique. Le troisième cycle comprend la quatrième, la cinquième et la sixième année. A la fin de la quatrième année, le séminariste est ordonné diacre. Durant sept ans, le séminariste se prépare à sa vocation de prêtre grâce à une formation spirituelle, intellectuelle, humaine, apostolique et pastorale.
Pour les femmes ayant la vocation de donner leur vie au Christ, il est possible de devenir religieuse ou moniale.
RCF vit grâce à vos dons
RCF est une radio associative et professionnelle.
Pour préserver la qualité de ses programmes et son indépendance, RCF compte sur la mobilisation de tous ses auditeurs. Vous aussi participez à son financement !