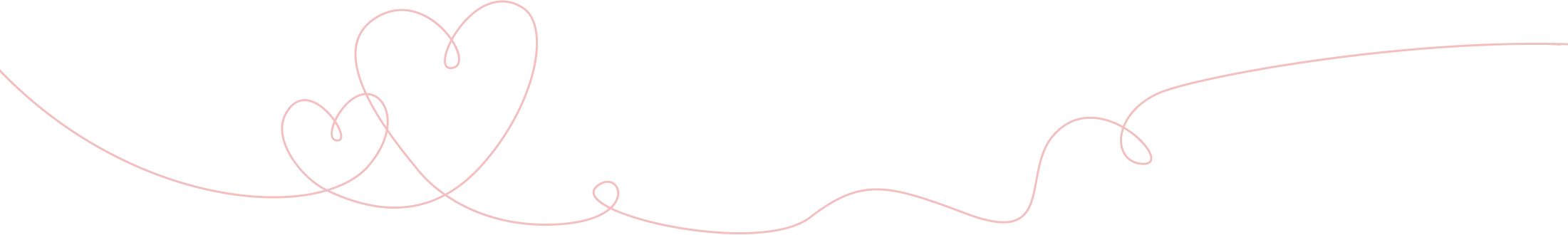Chronique : Les éditions imprimées de la Bible
Toutes les deux semaines, Sophie Robert-Hayek, chercheuse en théologie à l'Université de Lorraine, rejoint RCF Jerico Moselle dans l'émission Entre midi, entre Lorrains.
Ce lundi 17 février, elle nous raconte l'histoire des premières éditions imprimées de la Bible.
Ce sujet vous intéresse? Retrouvez cette chronique juste ici.
 Sophie Robert-Hayek dans l'émission de Entre midi, entre lorrains du 17/02/2025.
Sophie Robert-Hayek dans l'émission de Entre midi, entre lorrains du 17/02/2025.Quelque soit l’œuvre littéraire que nous consultons, nous prenons désormais pour acquis que celle-ci soit imprimée et standardisée... La Bible n’y fait pas exception ! Si par son statut exceptionnel dans l’Europe occidental celle-ci a fait partie des premiers livres imprimes, son histoire est loin d’être linéaire.
Alors déjà, un petit rappel sur l’imprimerie ?
A la fin du XVe siècle, l’Europe est à un tournant, avec la combinaison de trois évènements avec lesquels les historiens déterminent le tournant vers l’Ere Moderne.
D’abord, il y a la chute de Constantinople en 1453, prise par les troupes ottomanes. S’écroule alors ce qui restait de l’Empire d’Alexandre et de l’Empire Romain, c’est à dire une domination de plus de 15 siècles sur le bassin méditerranéen, qui était devenu l’emblème du bastion de la chrétienté en Orient. S’efface alors la ville de Constantin, l’un des derniers Empereurs à avoir régné sur un Empire Romain unifié.
Puis, il y la découverte de l’Amérique en 1492, sans rentrer dans les détails des débats de possibles découvertes Européennes antérieures. C’est cette date que l’Europe retient, et qui la marquera profondément : le monde connu s’étend de plusieurs milliers de kilomètres.
Et l’imprimerie dans tout ça ?
Enfin, et c’est la dernière révolution, c’est celle de l’invention de la typographie en caractères mobiles, c’est à dire l’imprimerie, et l’on doit au joaillier Johannes Gutenberg d’avoir su catalyser trois facteurs : la démocratisation de l’utilisation du papier plutôt que du parchemin, l’invention de nouveaux types d’encre, et l’amélioration des techniques de métallurgie qui vont permettre la création des caractères de typographie à l’unité.
Dans une Europe de plus en plus demandeuse de livre, et tout particulièrement de Bible, avec la naissance des premières traductions en vernaculaire, l’imprimerie introduit tout simplement une révolution dans la manière de penser la circulation de l’information en Europe. C’est d’ailleurs à cela que l’on doit possiblement la naissance du protestantisme.
La naissance du protestantisme ?
Et oui, Luther n’est pas le premier à avoir critiqué les pratiques catholiques de son temps, et je pense notamment à la figure française de Pierre Valdo au 12e siècle ou bien au théologien tchèque Jean Huss qui sera brulé en 1415 pour hérésie.
Luther n’est ainsi historiquement le seul à avoir proposé une Réformation de l’Eglise, mais c’est le premier a pouvoir diffuser ses écrits aussi vite et gagner le soutien de plusieurs intellectuels Européens, tout en s’assurant la protection politique de Frédérique II de Saxe. Il a ainsi on peut dire surfer sur la vague de pouvoir reproduire extrêmement rapidement ses écrits, et des premières fois où l’on peut garantir un texte standardisé d’un bout à l’autre de l’Europe. Finalement, on peut dire que l’imprimerie aura changé à tout jamais le paysage social et politique de l’Europe.
On retient le nom de Gutenberg comme premier imprimeur. C’est à lui que l’on doit l’impression du premier livre ?
Oui, c’est à lui que l’on doit l’impression de la première Bible en 1456, qui est une Vulgate, c’est à dire la Bible en latin telle qu’utilisée de manière normative par l’Eglise catholique, et ce jusqu’en 1962.
Celle-ci est composée de 1286 pages, avec de grandes marges. Elle ressemble d’ailleurs énormément aux meilleurs manuscrits bibliques, avec un texte continu dispose en deux colonnes.
Les imprimeurs se considèrent finalement les héritiers des copistes, et emploie donc des règles de mise en page similaire, jusqu’à demander aux scribes eux-mêmes de proposer leur calligraphie pour réaliser les caractères typographiques.
En plus du nom de Gutenberg, on retient souvent le nom d’Erasme ?
Oui, tout à fait, on attribue à Erasme, né au milieu du XVe siècle et figure intellectuelle majeure de ce qu’on appelle maintenant l’humanisme européen, la légende d’avoir été le premier à proposer une édition imprimée de la Bible en grec, en mars 1516, dans le contexte d’un mouvement général de critique du texte de la Vulgate comme étant une mauvaise traduction du texte grec, qui est revenu en masse en Europe suite à l’exil des intellectuels chrétiens de Constantinople lors de la destruction de la ville. Avec la naissance des premières traductions en vernaculaires, c’est à dire dans la langue de tous les jours du peuple, comme celles, les traducteurs veulent revenir à un texte qu’ils estiment plus proche de l’original, c’est à dire le texte grec.
Vous parlez de légende ? Ce n’est donc pas vrai ?
C’est à la fois vrai et faux. En fait, on doit en réalité les efforts de retour à un texte le plus proche possible de l’original à l’Eglise catholique, et notamment au cardinal espagnol Cardinal Ximenes.
Celui-ci entreprend en 1502 l’un des travaux les plus ambitieux de l’histoire de la traduction de
la Bible : il souhaite réaliser une version imprimée du Nouveau Testament contenant en parallèle le Grec et le Latin, et de l’Ancien Testament comparant le Grec, le Latin, et l’hébreu. Cette Bible est alors appelée, à raison, la Polyglotte Complutensienne. Le Nouveau Testament est imprimé en 1514, ce qui en fait techniquement la première impression du Nouveau Testament en grec. Sauf qu’ils décident avant la publication du Nouveau Testament de terminer l’Ancien Testament, qui n’est achevé et imprimé qu’en 1517. Il faut alors attendre 1522 pour obtenir l’imprimatur, c’est à dire l’autorisation papale pour publier le livre et le diffuser.
Sauf qu’Erasme, contacte en 1515 par un éditeur suisse qui a eu vent des travaux qui ont lieu en Espagne, décide de prendre de vitesse l’équipe de Ximenes car il ne nécessite pas l’approbation du Vatican pour publier son texte. Il commence alors a travailler en 1515 sur son édition du Nouveau Testament en grec, qui sera fini en 1516, pour être imprimée et publiée dans la foulée. C’est ainsi qu’il a techniquement publie la première édition du Nouveau Testament en grec, mais on doit en réalité la première impression aux catholiques espagnols !


"Entre midi", ce moment de la journée qui n'existe qu'en Lorraine : les équipes locales de RCF vous invitent chaque jour de la semaine, en direct, pour prendre le temps d'analyser et comprendre l'actualité de notre région.
RCF vit grâce à vos dons
RCF est une radio associative et professionnelle.
Pour préserver la qualité de ses programmes et son indépendance, RCF compte sur la mobilisation de tous ses auditeurs. Vous aussi participez à son financement !