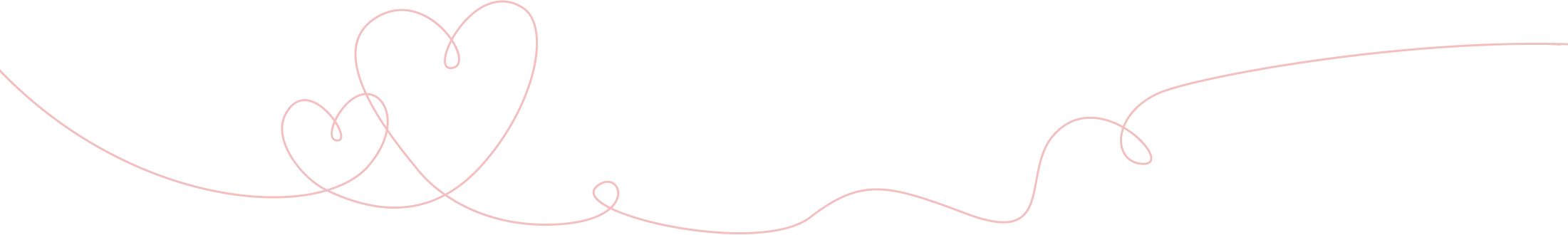Le travail transfrontalier : le débat est ouvert!
Le phénomène du travail transfrontalier entre la France et la Suisse soulève des débats. Entre augmentation du pouvoir d'achat pour les salariés et perte de compétitivité pour les entreprises françaises, de nombreux aspects d'encadrement sont à discuter. C'est la cas dans l'émission Focus de ce 31 janvier 2025. Nous avons reçu, un représentant du monde économique et un élu local. D'un côté, Emmanuel Viellard, président du MEDEF Franche-Comté, exprime ses inquiétudes quant à l'impact sur les entreprises françaises. De l'autre, Nolwenn Marchand, maire de Prémanon, défend une vision plus nuancée, soulignant les avantages pour le dynamisme local.
 © Pixabay - Werner Sidler
© Pixabay - Werner SidlerLa position du MEDEF : une préoccupation pour la compétitivité des entreprises françaises
Emmanuel Viellard, le président du MEDEF territoire comtois, pointe du doigt plusieurs problématiques majeures. Tout d'abord, il dénonce l'utilisation des fonds publics pour financer des infrastructures qui, selon lui, favorisent principalement le travail en Suisse au détriment des entreprises françaises. Il évoque des préoccupations concernant les systèmes d'assurance sociale. Sur l'assurance chômage, il souligne que les entreprises françaises supportent une charge importante des cotisations, alors qu'une partie des travailleurs frontaliers, bien que cotisant en France, bénéficient de salaires suisses plus élevés qui impactent leurs indemnités en cas de chômage. Au sujet de l'assurance maladie, il pointe du doigt le système de protection sociale français qui, selon lui, supporte des coûts significatifs pour des travailleurs qui exercent en Suisse, créant ainsi un déséquilibre dans le financement du système de santé français. Enfin, il cite, dans un autre domaine, l'exemple d'une augmentation de la taxe transport ayant coûté 880 000 euros à son entreprise, pour financer (en partie) la réouverture de la ligne SNCF Belfort-Delle, une ligne sous utilisée car les horaires ne sont pas adaptés aux travailleurs français.
Le président du MEDEF souligne également que les entreprises françaises, déjà les plus taxées au monde, se retrouvent à financer des infrastructures, spécialement de transport, qui servent à faciliter l'accès au marché du travail suisse. Cette situation crée, selon lui, un cercle vicieux qui fragilise encore davantage le tissu économique local français.
Moi j'apporte sur la table quasiment un milliard d'euros d'économies possible.
La vision du maire de Prémanon : un équilibre nécessaire
Nolwenn Marchand apporte une perspective différente, basée sur sa fonction d'élu local. Il souligne que le travail frontalier représente aujourd'hui un moteur économique essentiel pour les communes frontalières, avec environ 50% de la population active travaillant en Suisse dans certaines zones.
Le maire insiste sur le fait que les travailleurs frontaliers contribuent activement à la vie locale : ils participent aux associations, maintiennent le dynamisme du village et, grâce à leurs revenus, soutiennent l'économie locale. Il note par ailleurs que ces travailleurs, malgré des salaires plus élevés, font face à des coûts de vie importants, notamment en matière de logement.
On a quasiment doublé la population à Prémanon en 25 ans et c'est évidemment une part importante de travailleurs frontaliers qui sont venus qui sont venus s'installer chez nous.
Les enjeux de mobilité et d'environnement
Un point de convergence entre les deux positions concerne la nécessité de gérer efficacement les flux de travailleurs. Nolwenn Marchand souligne l'importance de trouver des solutions aux problèmes de mobilité, surtout en raison des enjeux environnementaux (60% des émissions de gaz à effet de serre dans la région étant liées aux transports) et de sécurité routière.
Cependant, comme le souligne Emmanuel Viellard, les solutions actuelles, telles que les infrastructures ferroviaires, ne semblent pas toujours adaptées aux besoins réels, avec des horaires peu pratiques et une utilisation limitée des services mis en place.
Perspectives d'avenir
Ce débat met en lumière la complexité de la gestion du travail transfrontalier. Surtout en ce qui concerne son encadrement légal. Il apparaît nécessaire de trouver un équilibre entre le soutien aux entreprises françaises et l'accompagnement d'un phénomène qui, qu'on le veuille ou non, fait partie intégrante de la réalité économique des zones frontalières.
La question des infrastructures et de leur financement reste centrale, tout comme celle de l'équité dans l'utilisation des fonds publics. Une réflexion approfondie sur ces enjeux semble indispensable pour assurer un développement harmonieux des territoires frontaliers.
Histoire inversée des travailleurs frontaliers en Franche-Comté
Aujourd’hui, les travailleurs frontaliers de Franche-Comté se rendent en Suisse pour travailler, mais pendant des siècles, c’était l’inverse. Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Suisses quittaient un pays pauvre et surpeuplé pour trouver du travail en France. Cette migration a pris différentes formes : d’abord les mercenaires, puis les domestiques, et enfin les salariés, notamment dans l’horlogerie, la fromagerie et l’industrie du bois.
À la fin du XVIIIe siècle, l’industrie horlogère suisse est en crise, poussant de nombreux horlogers à s’installer à Besançon. Parmi eux, Laurent Mégevand, un négociant genevois proscrit pour son soutien à la Révolution française. En 1793-1794, environ 850 migrants, principalement des familles d’horlogers, arrivent à Besançon. Mégevand y fonde en 1794 la Manufacture Française d’Horlogerie, avec l’appui de la République française, désireuse de développer son autonomie dans ce secteur. Il innove en introduisant la sous-traitance, faisant fabriquer les composants de montres par divers ateliers locaux. Cependant, l’entreprise fait faillite en 1798.
Après cet échec, une grande partie des migrants retourne en Suisse, mais entre 1814 et 1880, une nouvelle vague d’immigration horlogère suisse s’installe à Besançon. À son apogée, cette communauté représente près de 9 % de la population bisontine. Grâce à elle, l’industrie horlogère locale se développe et s’enracine durablement, faisant de Besançon la capitale française de la montre pendant de nombreuses années.
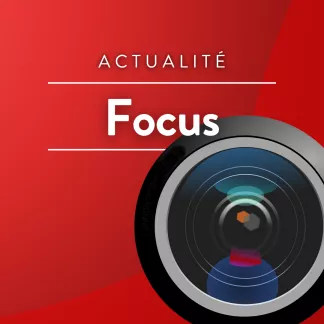

Chaque semaine, durant une heure, mise en avant d’une actualité au cœur de la Franche-Comté. Culture, écologie solidarité, Foi, économie, enseignement… de nombreuses thématiques seront explorées sous différents angles tout au long de l’année à l’aide d’un plateau d’invités.
Un regard autrement sur l’actualité près de chez vous !