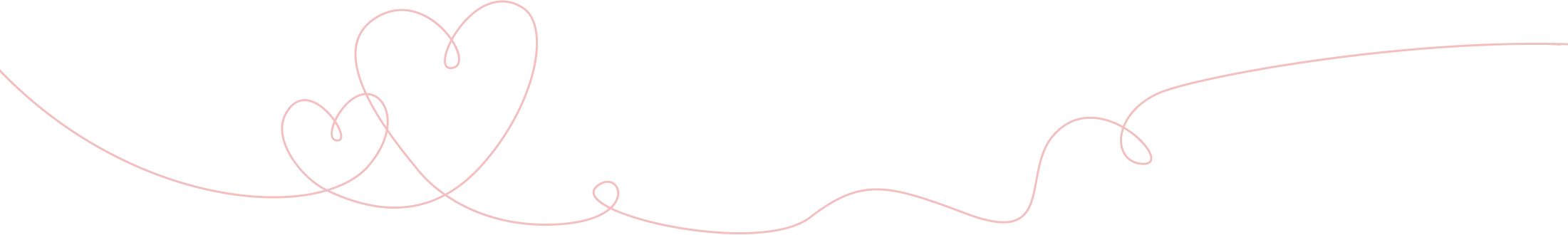Fin de vie : entre choix individuel et cadre législatif, quel éclairage des religions ?
Alors que le débat sur la fin de vie revient au Parlement, la question divise entre soins palliatifs et aide médicale au suicide. Quel rôle jouent les religions dans cette réflexion ? Entretien avec le pasteur François Clavairoly, contributeur au livre “Religions et fin de vie”.
 Fin de vie, entre choix individuel et cadre législatif © EREN
Fin de vie, entre choix individuel et cadre législatif © ERENLe débat sur la fin de vie refait surface au printemps 2025. Après un premier débat citoyen en 2023 soulignant l’urgence de renforcer les soins palliatifs, puis un projet de loi reporté en 2024 suite à la dissolution du Parlement, la question s’impose à nouveau.
Mais au-delà des enjeux législatifs, quel rôle jouent les religions dans cette réflexion ? Peuvent-elles offrir un éclairage sur l’accompagnement de la fin de vie ? Le pasteur François Clavairoly, contributeur du livre collectif Religions et fin de vie : Les témoignages de grandes voix religieuses (Fayard, 2023), nous aide à mieux saisir les dimensions spirituelles et éthiques de ce sujet intime et universel.
Des termes encore flous pour le grand public
La fin de vie est une réalité qui touche tout un chacun, mais les termes pour en parler restent souvent flous. Soins palliatifs, suicide assisté, accompagnement, directives anticipées… Ces notions, bien que distinctes, s’entremêlent dans les discussions publiques. "Nos avis diffèrent selon que nous parlons de notre propre fin de vie ou de celle d’un proche", explique le pasteur Clavairoly. Ce flou s’explique aussi par l’évolution du cadre législatif, qui, depuis les années 80, a cherché à structurer l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Un cadre législatif en mutation
Depuis la loi du 31 juillet 1991, qui a inscrit les soins palliatifs dans la mission des établissements de santé, plusieurs avancées ont été réalisées, notamment avec la loi du 9 juin 1999 garantissant un accès élargi à ces soins. En 2005 puis en 2016, la loi Leonetti a instauré les directives anticipées, permettant aux patients d’exprimer leurs volontés à l’avance. Pourtant, en 2025, la situation reste insatisfaisante : la France ne dispose que de 8 000 à 10 000 lits de soins palliatifs, une offre insuffisante face à la demande croissante. "Il existe encore de nombreux déserts médicaux où ces soins sont inaccessibles", rappelle François Clavairoly.
Deux textes distincts pour répondre à des besoins différents
Contrairement au projet initial, qui visait à intégrer l’aide médicale au suicide et le développement des soins palliatifs dans un texte unique, deux propositions de loi distinctes sont désormais envisagées : l’une portant sur le renforcement des soins palliatifs, l’autre sur l’aide médicale au suicide. "Il s’agit d’un débat essentiel où chaque conviction pourra s’exprimer", souligne le pasteur. Aujourd’hui, les personnes souhaitant une aide médicale au suicide doivent se rendre à l’étranger, faute d’un cadre légal en France. Ce constat invite à une réflexion collective sur l’accompagnement de la fin de vie dans des situations extrêmes.
Quelle place pour les religions ?
Les religions ont toujours joué un rôle dans la réflexion éthique autour de la fin de vie. Le livre Religions et fin de vie rassemble les témoignages de représentants de diverses confessions, apportant des perspectives complémentaires sur l’accompagnement des mourants. "Les traditions spirituelles ne sont pas là pour imposer une vision unique, mais pour aider chacun à cheminer avec ses propres convictions", conclut François Clavairoly. Dans un débat souvent polarisé entre éthique et droit, elles offrent une approche fondée sur l’écoute et la dignité de chaque personne.
Une question qui nous concerne tous
La fin de vie est à la fois une question intime et un enjeu collectif. Le retour du projet de loi en 2025 marque une étape décisive, mais le débat ne saurait se limiter aux sphères législatives et médicales. Il engage aussi une réflexion profonde sur notre rapport à la mort, au soin et à l’accompagnement des plus vulnérables. C’est pourquoi il reste essentiel que toutes les voix, y compris celles des religions, puissent contribuer à éclairer ce chemin difficile mais fondamental.


L’émission est une carte blanche à l’Église protestante unie de France : regard protestant sur un thème de société, d’actualité, de culture, d'art.