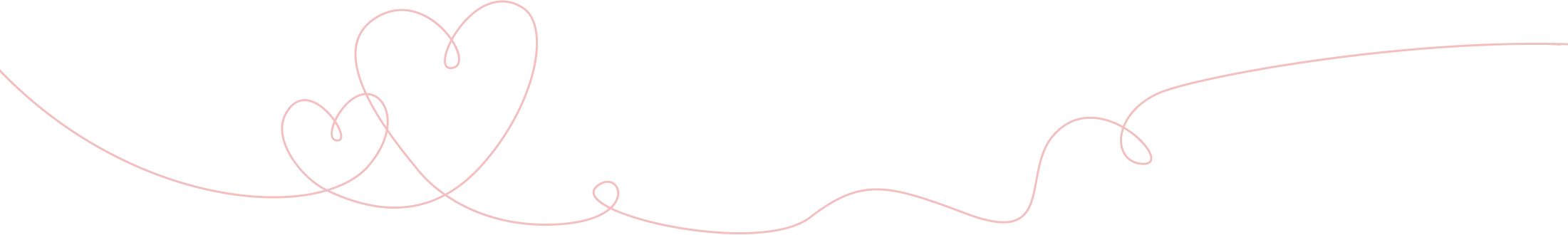Lyon : sur les quais de Saône, une église du XVIIIe siècle rend hommage à l'Antiquité
Coincée entre deux immeubles des quais de Saône, l’église Notre-Dame-Saint-Louis-Saint-Vincent peut facilement passer inaperçue à Lyon. Le curieux qui réussit à y pénétrer pourra découvrir un intérieur de prime abord un peu austère. Mais un regard plus attentif lui permettra d’apprécier ce qui fut une des réalisations d’avant-garde de l’architecture néoclassique française du XVIIIe siècle.
 Lyon, Notre-Dame-Saint-Vincent, quai Saint-Vincent © Wikicommons
Lyon, Notre-Dame-Saint-Vincent, quai Saint-Vincent © WikicommonsSon nom officiel est « Notre-Dame-Saint-Louis-Saint-Vincent » mais elle est surtout connue aujourd'hui sous le nom d'église « Notre-Dame-Saint-Vincent » et a d'ailleurs donné son nom au quai où elle se situe.
En juin 1789, un mois avant la prise de la Bastille, les Pères Augustins du quartier des Terreaux sont en fête. Après trente ans de travaux, leur église est enfin achevée. L'édifice est dédié à saint Louis, en hommage au dauphin, le fils du roi Louis XV qui avait patronné la pose de la première pierre en 1759. L'église nouvelle remplace une ancienne chapelle gothique devenue vétuste. Plutôt que de la reconstruire à l’identique, les religieux choisissent un projet novateur du jeune architecte lyonnais Léonard Roux (1725-1793).
L'ambition de la construction ne s’exprime pas dans la dimension du bâtiment, assez modeste – la nef sera rallongée de deux travées vers le quai en 1861-82 – ni dans la richesse du décor, volontairement épuré. Il s’agit en fait d’édifier une église selon les toutes dernières théories architecturales en vogue au milieu du XVIIIe siècle qui prônaient le retour à des formes architecturales de l’Antiquité dont la connaissance est alors renouvelée grâce aux premières campagnes archéologiques menées en Italie et en Grèce.
Derrière son portail richement sculpté de la fin du XIXe siècle, on remarque surtout une double colonnade dorique sur laquelle repose une voûte en plein-cintre aboutissant à une large coupole. À l’image des temples grecs, les murs latéraux ne sont pas percés de fenêtres, toute la lumière tombe des baies perçant la voûte et de du dôme surmontant la croisée du transept. Une simple abside semi-circulaire termine l’édifice.
 Nef de l'église Notre-Dame-Saint-Vincent, Lyon © Wikicommons
Nef de l'église Notre-Dame-Saint-Vincent, Lyon © WikicommonsContrairement à de nombreuses églises restaurées après la Révolution française, Notre-Dame-Saint-Vincent n’a pas été recouverte de peintures ou de mosaïques au XIXe siècle. Elle a conservé la grande sobriété de ses formes qui mettent en valeur sa maçonnerie de belle pierre de taille et les ornements de son architecture. Surtout, sa luminosité se distingue des édifices gothiques très colorés en faisant le choix de larges verrières blanches éclairant sobrement les grandes surfaces claires de pierre nue. À la place de la symbolique médiévale d’une lumière chargée d’histoire par les vitraux densément peuplés de figures saintes se développe une réflexion sur un éclairage à la fois plus efficace, à l’usage des fidèles, et évoquant le Ciel par une lumière venant d’en haut et limpide, à l’image de la perfection divine.
L’architecture des premières églises
Ce projet était très original dans la France des années 1750. Depuis le XVIe siècle, les églises étaient construites dans l’esprit insufflé par le Concile de Trente, utilisant des formes antiques mais selon des schémas inspirés de la tradition gothique et de la Renaissance italienne. Les pères augustins firent le choix d’une architecture renouvelée par quelques théoriciens et amateurs d’art mais alors encore peu mise en œuvre. Le premier projet de ce genre n’avait été lancé que deux ans plus tôt à Paris par l’architecte lyonnais Jacques-Germain Soufflot pour l’église Sainte-Geneviève, devenue le Panthéon. De très grande ampleur, ce chantier sera aussi très long, à peine achevé en 1790. Ces deux prototypes seront suivis par quelques autres dans les années 1760-70, surtout autour de Paris (Montreuil, Saint-Germain-en-Laye…). Ce style d’église néoclassique prendra vraiment son essor dans la première moitié du XIXe siècle, par exemple Saint-Pothin, construite de 1841 à 1843 dans le quartier des Brotteaux.
Le choix de la colonne libre et d’un entablement droit (structure horizontale supportant la voûte ou le toit), sans arcade, était en rupture avec les modèles de la Renaissance italienne et du classicisme français. Il s’agissait d’être plus fidèle aux modèles de l’Antiquité, c’est-à-dire aux premiers temps de l’Église. C’est pourquoi des ecclésiastiques du XVIIIe siècle virent dans les monuments de l’empire romain la meilleure source d’inspiration pour reconstituer les églises des premiers chrétiens en Gaules. Lorsque Constantin les autorise à construire des lieux de cultes publiques (313), les communautés chrétiennes mobilisèrent les techniques et les arts de leur temps. La structure des temples ne convenant pas à la réunion d’une communauté, ils s’approprièrent plutôt la forme de la basilique civile, une vaste salle de tribunal couverte par une charpente reposant sur deux fils de colonnes et terminée par une abside semi-circulaire où siégeait le juge.
 Coupe Le Roux de l'église Notre-Dame-Saint-Vincent © BM Lyon
Coupe Le Roux de l'église Notre-Dame-Saint-Vincent © BM LyonUne architecture théologique : En adoptant la forme de la basilique civile, les premiers chrétiens l’adaptent à leur théologie naissante. L’assemblée (ecclesia) des fidèles d’une ville est l’expression locale de la réunion de tous ceux qui composent l’Église universelle. Le bâtiment qui les abrite - l’église - devient image de l’Église que saint Paul décrit comme un corps qui est aussi celui du Christ (1 Cor 12, Eph 4). C’est pour matérialiser le lien Église-corps, local, universel et christique, que le plan de l’édifice devient anthropomorphe, à la foi corps humain et corps du crucifié – jambe et torse pour la nef, sanctuaire pour la tête – en ajoutant à la basilique rectangulaire un espace transversal, les bras du transept. C’est le plan en croix devenu traditionnel dans toute la chrétienté. Il ne reste plus en France que des fondations de ces édifices de l’antiquité chrétienne, par exemple les anciennes églises Saint-Césaire d’Arles et Saint-Just de Lyon, mais en Italie certaines basiliques mieux préservées peuvent encore les évoquer.
Notre-Dame-Saint-Vincent, projet innovant mais un peu oublié, est donc un précieux témoin de cet intérêt récurrent des communautés chrétiennes de l’époque moderne pour les premiers temps de l’Église, non seulement par la littérature et la théologie des Pères mais aussi pour ses formes plus concrètes comme les pratiques liturgiques et l’architecture.
RCF vit grâce à vos dons
RCF est une radio associative et professionnelle.
Pour préserver la qualité de ses programmes et son indépendance, RCF compte sur la mobilisation de tous ses auditeurs. Vous aussi participez à son financement !