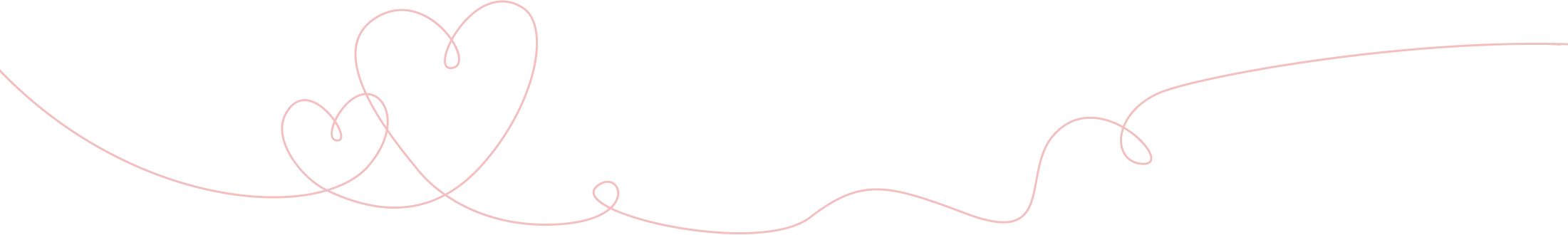- Je fais un don
- Je fais un don IFI
- Pourquoi donner ?
- Fondation RCF
- Legs, Donation, Assurance-vie
- Qui sommes-nous ?
- Les fréquences
- Nos partenaires
- Nous contacter
Livres, films, bandes dessinées... Des œuvres qui entretiennent la mémoire de la Shoah
À l'occasion des quatre-vingts ans de la libération des camps de la mort, les chroniqueurs d’Effervescence ont sélectionné des œuvres qui s'attellent à faire perdurer la mémoire de la Shoah.
 Le camp d'Auschwitz, le 27 janvier 1945 ©wikimédia commons
Le camp d'Auschwitz, le 27 janvier 1945 ©wikimédia commonsLa libération des camps nazis a commencé dès le milieu de l’année 1944. Avec la découverte des premiers camps à l’est de la Pologne par l’armée rouge. Ses soldats sont arrivés à Majdanek-Lublin le 24 juillet 1944, puis ont découvert un second camp de concentration et d’extermination, Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier 1945. Ce jour-là, les troupes ont libéré les quelque 7.000 prisonniers qui restent, trop faible pour avoir été évacués par les nazis dans la marche de la mort.
La France a donc choisi la date du 27 janvier pour la journée de mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Auschwitz-Birkenau symbolise le génocide des juifs, dont il est le lieu principal. 1,3 millions de personnes y ont été déportées, 1,1 de personnes y sont mortes. 90% d’entre elles étaient juives. Les chroniqueurs d’Effervescence ont sélectionné des œuvres qui entretiennent la mémoire de la Shoah.
Bande dessinée - "Les mémoires de la Shoah", d’Annick Cojean
La bande dessinée "Les mémoires de la Shoah", paru en ce mois de janvier 2025, raconte les enquêtes d’Annick Cojean. Journaliste au Monde, elle avait reçu le prix Albert-Londres en 1996 pour cet immense travail d’enquête réalisé à l’occasion du cinquantième anniversaire de la libération des camps.
"Ces mémoires qu’elle veut faire vivre, ce sont celles des survivants, ceux qui longtemps n’ont pas ou peu parlé et surtout n’ont pas été écoutés. Jusqu’à ce que l’université de Yale leur donne la parole : c’est vraiment le point de démarrage de son enquête", explique notre chroniqueuse Victoria Jacob, rédactrice en chef du magazine Phosphore.
En écoutant les témoignages des quelque 3.000 témoignages de rescapés, Annick Cojean "a pris conscience de l’importance de ces témoignages, plus encore de tout ce qui a été dit sur la Shoah… Parler peut guérir mais uniquement si on est écouté." Victoria Jacob recommande la lecture des "Mémoires de la Shoah" même si parfois il est "difficile à lire", en particulier lorsque la parole est donnée aux descendants des nazis. Le travail d’Annick Cojean montre que le traumatisme se transmet et combien il peut marquer les enfants des survivants... et aussi des bourreaux.
Annick Cojean - Baudouin – Rojzman, « Les mémoires de la Shoah », éditions Dupuis, 2025, 25 euros
Livre - "Les Disparus", de Daniel Mendelsohn
Odile Riffaud recommande ce livre emblématique de la littérature de la Shoah portée par ceux qu’on appelle les non-témoins, qui n’ont pas vécu la Shoah. Son auteur, Daniel Mendelsohn, est un critique littéraire américain, qui enseigne aux États-Unis. La publication de son livre en 2006 a fait l’effet d’un "coup de tonnerre" selon l’essayiste Maxime Decout, auteur de "Faire trace" (éd. Corti, 2023).
"Les Disparus" est le récit de l’enquête qu’a menée Daniel Mendelsohn pour découvrir les circonstances de la mort de son grand-oncle, de son épouse et de leurs quatre filles, tous assassinés par les nazis. Après lui beaucoup d’écrivains se sont lancés dans des enquêtes sur leurs ancêtres disparus. La plupart du temps à partir de peu d’éléments : le "manque d’archive" est d’ailleurs au cœur de la réflexion de Maxime Decout. Cette littérature d’enquête après la Shoah permet de dire les drames individuels, ce qu’empêche la dimension collective du génocide.
Daniel Mendelsohn fait appel à la Genèse pour étoffer son récit et rejoindre par les mythes bibliques les trajectoires personnelles. En insérant dans son texte des commentaires de la Bible, le narrateur se fait à la fois enquêteur et exégète. Il livre un travail d’interprétation sur ce qui est donné de savoir. Daniel Mendelsohn est un helléniste. Dans son œuvre il met en parallèle la pensée hébraïque, qui entretient l’idée qu’il y a des zones d’ombre et que la vérité appartient à Dieu, et la pensée grecque, qui postule que l’on eut accéder au savoir.
Daniel Mendelsohn, "Les Disparus", trad. Pierre Guglielmina, éd. Flammarion, 2007, 26,50 euros
Roman graphique - "Maus", d’Art Spiegleman
C’est un incontournable qui a marqué l’histoire du roman graphique publié aux États-Unis entre 1980 et 1991. Art Spiegelmann, célèbre dessinateur du New Yorker, livre le témoignage de son père rescapé de la Shoah. "C’est assez fort et dur, à ne pas mettre en toutes les mains, recommande Stéphane Dreyfus, journaliste au service culturel de La Croix. Âmes sensibles s’abstenir !"
À la fois témoignage, autobiographie, biographie, ouvrage documentaire, "Mauss" est un inclassable qui a beaucoup marqué le roman graphique par l’ampleur de son récit et la force de son témoignage. Art Spiegelmann, dont le père avait été préposé au nettoyage des fours crématoires, raconte sans fard l’horreur des camps. Dans ce récit les Juifs sont des souris, les Allemands des chats, les Polonais des cochons, ce qui a suscité à sa parution beaucoup de critiques. Pour Stéphane Dreyfus, cela permet une mise à distance et aide à supporter le tragique et l’horreur du récit.
Art Spiegelman, "Maus - L'intégrale", éd. Flammarion, 2019, 30 euros
Bande dessinée - "Victory parade", de Leela Corman
"Victory parade" raconte la fin de la guerre et la libération des camps du côté américain. La vision effroyable de prisonniers décharnés et malades hantera encore longtemps les jeunes américains qui en ont été témoins. La bande dessinée parle d'une victoire au goût amer où ceux qui ont survécu à l’enfer préfèreront être morts pour ne plus voir ce qu’ils ont vu. Ce livre rappelle qu’il y a aussi des perdants parmi les vainqueurs.
"Un choc graphique" pour Stéphanie Gallet, qui en recommande la lecture. Leela Corman s’est beaucoup inspirée de l’œuvre d’Otto Dix, expressionniste qui a eu son heure de gloire pendant la République de Weimar, avant d’être considéré comme un artiste dégénéré par les nazis. Un livre que ses lecteurs ne sont pas prêts d’oublier.
Leela Corman, "Victory parade", trad. Jean-Paul Jennequin, éditions Çà et là, 2024, 25 euros
Film - "La zone d’intérêt", de Jonathan Glazer
Jonathan Glazer, réalisateur britannique qui aime les expérimentations plastiques et formelles, a choisi de représenter les camps en laissant l’intérieur des camps quasiment hors champs, décrit Stéphane Dreyfus. "Il raconte la vie quotidienne de ce qui semble être une charmante famille qui coule des jours heureux. Et on découvre médusés qu’en fait il s’agit de la famille du commandant des camps d’Auschwitz, Rudolf Höss."
Un film assez glaçant qui laisse l’horreur des camps quasiment hors champs. "Les expérimentations formelles de son réalisateur ont quelque chose de gênant, pour Stéphane Dreyfus. Elles donnent l’impression que le réalisateur veut se mettre en avant."
Documentaire - "Sauver Auschwitz ?", de Jonathan Hayoun
Dans "Sauver Auschwitz ?" (2017), Jonathan Hayoun retrace l’histoire du camp d’Auschwitz-Birkenau depuis sa libération en janvier 1945. Il montre la façon dont l’histoire des lieux a été récupérée au cours de son histoire, notamment par la propagande soviétique. Aujourd’hui encore, la politique mémorielle en Pologne fait débat. Odile Riffaud recommande de lire sur ce sujet un article de la Revue K : "Négationnisme à la polonaise : le cas du site de Treblinka" du 11 décembre 2024.
La question qui traverse le documentaire est : Que faire d’Auschwitz ? Un musée ou un mémorial ? S’il y a eu un musée dès 1947, la question de la mémoire est compliquée. Ainsi, les noms des victimes ne figurent nulle part. Il n’y a pas non plus vraiment de lieu où se recueillir. Certains mettent des bougies sur les voies ou se tiennent respectueux devant les crématoires – et pas devant les fosses communes.
Dans quel état d’esprit visiter Auschwitz ? Le camp accueille chaque année en moyenne deux millions de visiteurs. Un tourisme de masse assez peu propice au recueillement. En 2019, un rappel à l’ordre a été diffusé, destiné à ceux qui s’amusaient à marcher en équilibre sur les voies de chemin de fer. Le camp, autour duquel l’Unesco ne parvient pas à instaurer une zone de silence, est aussi un lieu de tensions avec les habitants de la ville d’Oswiecim – Auschwitz en polonais – qui n’a cessé de se développer depuis 1945.
Film d’animation - "La plus précieuse des marchandises", de Michel Hazanavicius
Un film d’animation "important", pour Stéphane Dreyfus. Comme le dit Michel Hazanavicius, à l’heure où sort de l’ère du témoignage, on a besoin de la fiction il faut trouver des récits pour raconter et transmettre la mémoire de la Shoah.
Michel Hazanavicius reprend la structure narrative du conte détourné de Jean-Claude Grumberg, (2018). Il ôte toute mention directe aux camps, il ne parle pas de "Juifs" mais de "sans-cœur". Là encore pour un effet de mise à distance, qui lui donne une dimension universelle. La "marchandise" n’est autre qu’un bébé jeté d’un train – on notera l’allusion biblique – recueillis par une femme de bûcheron. Son mari, lui n’en veut pas avant de se rendre compte que les « sans-cœur » en ont un.
On sort parfois du conte avec des plans fixes, qui suggèrent l'horreur des camps. "Je trouve que ce n’est pas la dimension la plus intéressante du film, confie Stéphane Dreyfus. Je trouve que le film n’est jamais plus fort et touchant que quand il est dans cette dimension de conte."
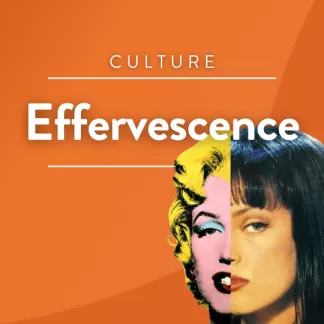

Le magazine de l’étonnement culturel. Chaque semaine, trois à quatre passionnés de culture, issus du réseau RCF ou d’autres médias, viennent partager leurs découvertes et leurs enthousiasmes dans tous les domaines de la culture et de la création artistique.
Pour aller plus loin
Suivez l’actualité nationale et régionale chaque jour

- 27 janvier 2025
- 27 novembre 2023
RCF vit grâce à vos dons
RCF est une radio associative et professionnelle.
Pour préserver la qualité de ses programmes et son indépendance, RCF compte sur la mobilisation de tous ses auditeurs. Vous aussi participez à son financement !