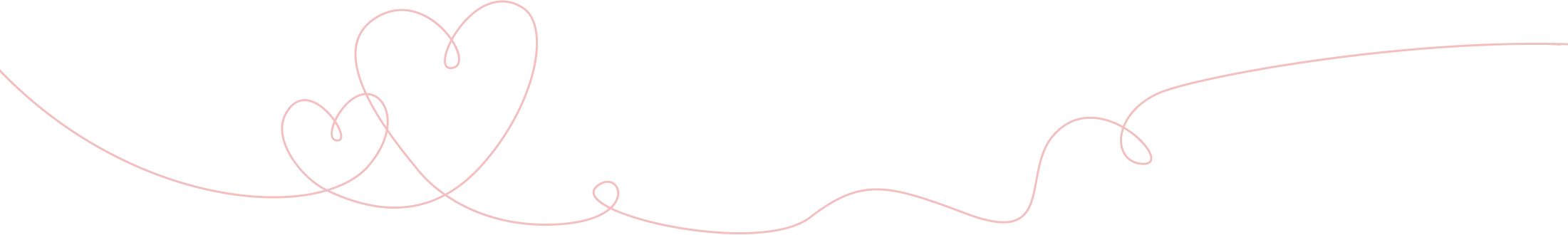Lyon : au sein de l'hôpital Edouard-Herriot, une chapelle art-déco
Au cœur d’un complexe hospitalier moderne, il est bien rare de trouver une chapelle. Pourtant, au sein de l’hôpital Edouard Herriot à Lyon, elle est discrètement nichée entre le service IRM et les laboratoires de pharmacie. Il s'agit d'un exemple remarquable d'architecture religieuse art-déco.
 Chapelle de l'Hôpital Edouard-Herriot à Lyon ® Clément Savary
Chapelle de l'Hôpital Edouard-Herriot à Lyon ® Clément SavaryÀ la veille de la Première Guerre mondiale, le maire de Lyon Édouard Herriot décide la construction à Grange-Blanche d’un nouveau centre hospitalier pour accueillir différents services des Hospices lyonnais abritées jusqu'alors à l’Hôtel-Dieu et à l'hôpital voisin de la Charité en Presqu'île. Le projet est confié à Tony Garnier qui venait de commencer la construction des abattoirs de la Mouche – future Halle Tony Garnier – et qui reçut la commande du stade Gerland trois ans plus tard.
Lorsque le chantier de l'hôpital commence en 1911, il n’est pas prévu de chapelle. Sa construction est demandée par l’administration des Hospices pour que la soixantaine de sœurs hospitalières au service des malades puisse se recueillir sur place.
Sa conception est confiée en 1924 à Louis Thomas, associé de Tony Garnier. Sa position dans le plan général de l’hôpital et son orientation vers la rue montre qu’elle fut résolument conçue comme une chapelle funéraire plutôt qu’un oratoire destiné aux malades.
Ce basculement rend compte de la laïcisation de la conception de l’hôpital, évoluant progressivement de la préoccupation charitable des échevins de l’Ancien Régime aux soucis de santé publique des municipalités.
 Transept Est de la chapelle de l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon - © Clément Savary
Transept Est de la chapelle de l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon - © Clément SavaryDe taille modeste avec ses 15 mètres de longueur, la chapelle est construite sur un plan centré en croix grecque, douze colonnes délimitant un déambulatoire et supportant un tambour octogonal à plafond plat, offrant un espace dégagé et très unifié par la sobre géométrie des formes. Malgré leur hauteur, les murs sont aveugles afin de concentrer toutes les sources lumineuses dans les parties hautes, en particulier le tambour constitué de blocs de verre violet, rouge, bleu et jaune incrustés dans une résille de béton qui composent un bandeau de vitrail continu diffusant une lumière douce et chamarrée.
Un chemin de résurrection
Au milieu de ces formes et de ces couleurs tournées vers l’abstraction, dans l’esprit de renouveau de l’art-déco, quelques images attirent l’attention afin d’orienter la méditation des visiteurs. Au centre du plafond de chacun des côtés du déambulatoire se trouvent quatre vitraux carrés conçus par le peintre lyonnais Adrien Godien (1873-1949). La mise en scène de figures du Nouveau-Testament permet de construire un cheminement spirituel au sein de l’édifice.
 Vitrail ouest de la chapelle de l'hôpital Edouard-Herriot © Clément Savary
Vitrail ouest de la chapelle de l'hôpital Edouard-Herriot © Clément Savary Christ de Georges Salendre, chapelle de l'hôpital Edouard-Herriot - © Clément Savary
Christ de Georges Salendre, chapelle de l'hôpital Edouard-Herriot - © Clément SavaryAu-dessus de la porte principale sont représentées Marthe et Marie autour de Jésus (Lc 10, 38-42). D’une main il repousse les pots que tient Marthe, image de son service affairé, de l’autre il pointe le Ciel, appelant l’attention sur ses paroles. Tout en désignant le lieu dans lequel on entre comme un espace de prière plutôt que de soin, ce choix iconographique souligne l’importance de l’écoute dans la préparation chrétienne. Cette intériorisation est valorisée dans la maladie autant que dans le deuil. Au malade elle souligne que ce temps d’inactivité qu’est la convalescence peut être un temps de conversion. Aux familles elle rappelle que l’existence ne s’arrête pas à la vie terrestre mais que les Écritures nous font espérer la proximité avec Dieu dans l’au-delà. Placée à l’entrée, cette scène invite à consacrer le temps passé dans ce lieu à l’écoute de la Bonne Nouvelle.
Apprendre à bien mourir
Surplombant les chapelles de la Vierge et de saint Joseph, deux vitraux représentent des scènes issues de la tradition, respectivement une Piéta, Marie pleurant le corps de son fils, et la Mort de saint Joseph. L’une et l’autre incarnent les deuils les plus intimes, au cœur de la famille, auxquels Jésus a été lui-même confronté.
La Mater dolorosa, déchirée par la mort incompréhensible d’un enfant, évoque le mystère de la souffrance de l’innocent. Le thème de la mort de Joseph entouré de Jésus et de Marie devint très populaire à partir du XVIe siècle comme image de la « bonne mort », c’est-à-dire une mort vécue comme une ultime épreuve et un moment de préparation particulière à l’aboutissement de la vie chrétienne.
Elle se concentre moins sur la solidarité familiale que sur la disposition du mourant dans ses derniers moments, en particulier par le sacrement de la Réconciliation. Dans les deux cas sont mis en avant l’expérience directe que Dieu eut de ces vulnérabilités humaines par son existence terrestre, ainsi que la solidarité que les chrétiens présents peuvent trouver dans l’intercession des saints, tout particulièrement la mère et père adoptif du Sauveur.
Au-dessus de l’autel se trouve enfin la parabole du Bon Samaritain (Lc 10, 25-37). Il ne s’agit plus ici d’épisodes de la vie de Jésus, mais de l’image de la compassion par excellence, celle qui se détourne de son chemin pour venir en aide à l’étranger, celle qui ne compte pas ses efforts, portant non seulement un secours direct mais prenant aussi à sa charge les longs soins de la guérison. Son emplacement, directement au-dessus de la croix monumentale sculptée par Georges Salendre, rappelle l’interprétation des Pères de l’Eglise qui dépassent le commentaire moral, l’exigence de charité envers tous les humains. Selon saint Clément d’Alexandrie ou saint Ambroise de Milan, le Samaritain n’est plus une figure du comportement chrétien mais montre le Christ se dévouant par amour au salut de l’humanité blessée par le péché originel.
Ce programme iconographique propose ainsi une méditation sur la fin de notre existence terrestre, se mettant à l’écoute de la Parole pour se préparer à affronter le deuil et la mort en méditant sur le sacrifice rédempteur du Sauveur.
Pour visiter : ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, accès par l’entrée principale de l'hôpital Edouard-Herriot (5 place d'Arsonval, 69008 Lyon), bâtiment 11.
RCF vit grâce à vos dons
RCF est une radio associative et professionnelle.
Pour préserver la qualité de ses programmes et son indépendance, RCF compte sur la mobilisation de tous ses auditeurs. Vous aussi participez à son financement !