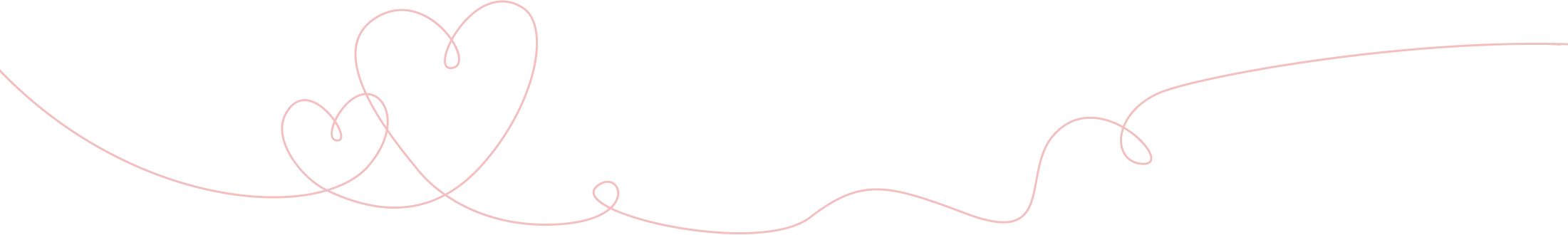Valérie Depériers et Bernadette Verpaele : humanisons les prisons
Clotilde Nyssens accueille deux aumônières de prison, Valérie Depériers et Bernadette Verpaele, qui partagent leur expérience et leur mission au sein des établissements pénitentiaires de Haren et de Saint-Gilles. Quel est le rôle de l'aumônerie en milieu carcéral ? Quels défis quotidiens faut-il faire face ? Comment humaniser les prisons et préparer un rebond voire une seconde chance ?
 Valérie Depériers et Bernadette Verpaele, aumonières de prison
Valérie Depériers et Bernadette Verpaele, aumonières de prisonParcours et motivations des aumônières
Valérie Depériers, carmélite de Saint-Joseph, exerce depuis quatre ans en tant qu'aumônière à la prison de Haren, après avoir commencé à Forêt. Sa vocation est née d'une sensibilisation progressive au monde carcéral, notamment en suivant l'affaire Bertrand Cantat, qui l'a amenée à réfléchir sur la violence et la rédemption. Avant d'entrer en contact direct avec les détenus, elle a commencé par une correspondance avec des prisonniers via l'association "Le Courrier de Bovet".
Bernadette Verpaele, ancienne infirmière sociale ayant travaillé en psychiatrie, a commencé son engagement carcéral en 2002 au Sénégal, où elle a animé des ateliers d'artisanat pour les détenues. Son expérience dans plusieurs pays d'Afrique l'a conduite à remettre en question les préjugés occidentaux sur la justice et la prison. De retour en Belgique, elle a poursuivi son engagement à Saint-Gilles, préoccupée par la déshumanisation du système carcéral et l'absence de perspectives de réinsertion.
Le rôle et les difficultés des aumôniers en prison
Le travail des aumôniers s'articule autour de deux axes principaux : les visites individuelles en cellule et l'organisation d'activités religieuses, notamment des messes hebdomadaires. Cependant, les conditions de travail varient selon les établissements.
À Haren, les cellules sont principalement individuelles, offrant un cadre plus intime pour les échanges. À Saint-Gilles, la surpopulation est un problème récurrent, compliquant les interactions et obligeant souvent à recourir à des espaces communs ou des bureaux pour les rencontres.
Les aumôniers doivent naviguer entre différents statuts : salariés ou bénévoles, et ils travaillent en collaboration avec d'autres services (psychologues, travailleurs sociaux) tout en conservant une posture d'écoute et de soutien spirituel.
Les attentes et les besoins des détenus
Les détenus sollicitent les aumôniers pour diverses raisons : certains cherchent un soutien spirituel et participent à des échanges sur la foi, tandis que d'autres ont besoin d'une simple présence humaine pour évacuer leur solitude et leur souffrance. Beaucoup sont issus de milieux défavorisés et ont eu des parcours de vie chaotiques.
Un constat frappant est l'absence de prise de conscience chez certains quant à la gravité de leurs actes. Il n'est pas rare que des détenus ne comprennent pas pleinement les raisons de leur incarcération ou minimisent leur responsabilité. L'absence de perspectives réalistes de réinsertion, le manque de formation et le poids des antécédents judiciaires compromettent souvent leur avenir en dehors de la prison.
Le rôle des agents pénitentiaires et les limites du système
La discussion aborde aussi le rôle des agents de détention. À Haren, une tentative d'organisation avec des agents "accompagnateurs de détention" a été mise en place, mais sans les ressources suffisantes pour réellement remplir cette mission. De manière générale, les aumôniers constatent une insuffisance criante de formation des agents, ce qui complique leur relation avec les détenus.
Un autre point souligné est l'impact psychologique de l'enfermement, notamment sur les détenus présentant des troubles psychiatriques. La prison devient alors un espace inadapté à leurs besoins, aggravant leur détresse plutôt que de les aider.
Un regard critique sur la prison et ses enjeux
Les aumônières insistent sur l'importance d'une réflexion collective sur le sens de l'incarcération. Elles soulignent que la prison, telle qu'elle est aujourd'hui conçue, ne prépare pas à la réinsertion. Trop souvent, elle accentue les difficultés des détenus au lieu de les aider à reconstruire leur vie. Le manque de formation, l'isolement, la dépendance totale aux décisions de l'administration, ainsi que la stigmatisation post-carcérale rendent la réhabilitation très complexe.
Une mission d'écoute et d'humanité
Dans le fond, les deux aumônières insistent sur l'aspect fondamental de leur mission : apporter un regard bienveillant sur des individus que la société rejette souvent. Leur rôle n'est pas de juger, mais d'écouter et d'accompagner, en essayant d'offrir un espace de parole et d'espoir.
Bernadette souligne que la prison est un miroir de la société et qu’elle gagnerait à être plus en lien avec le monde extérieur pour permettre une réinsertion plus efficace. Valérie conclut en rappelant l'importance de l'amour et de l'accueil inconditionnel, illustrant ainsi la dimension spirituelle qui guide son engagement.
Quelle réflexion sur la justice, la rédemption et le rôle de la société dans l'accompagnement des détenus vers une seconde chance ?


Alimenter la quête de sens des décideurs et des personnes actives, pour un nouvel art de vivre, dans sa dimension quotidienne, qu'elle soit familiale, professionnelle, sociale ou politique. Témoignages inspirants de chercheurs de sens ou de chrétiens actifs.
En partenariat avec Translink CF www.translinkcf.com. Abonnez-vous à notre page Facebook.
Chaque mardi à 17h03, rediffusions mercredi à 5h et22h & dimanche à minuit et 16h03, sur 1RCF Belgique.