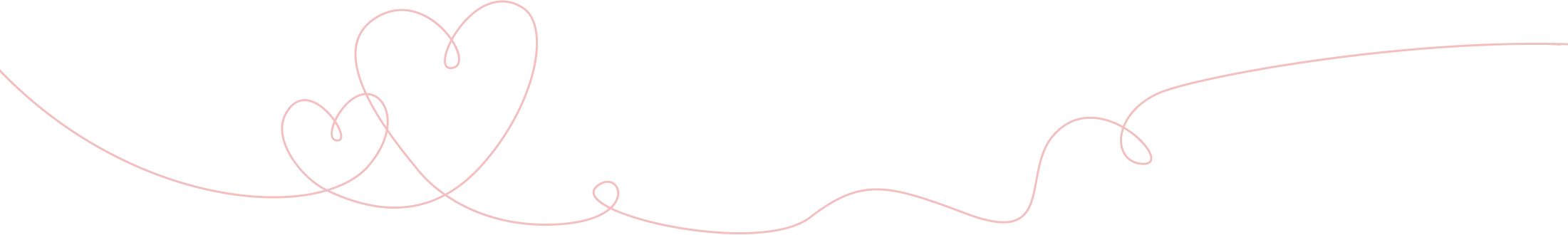Un an après l’attaque du 7 octobre : quel bilan pour Israël ?
 Version 1920x1080 1728309346
Version 1920x1080 1728309346Le 7 octobre 2023, le Hamas a mené une attaque contre Israël, causant la mort de plus de mille deux cents personnes. Cette date est devenue l’épisode le plus meurtrier pour la communauté juive depuis la Shoah. Israël, déjà marqué par de profondes divisions internes exacerbées par la réforme judiciaire de 2023, a vu sa population, qu'elle soit laïque ou religieuse, faire face à un bouleversement identitaire sans précédent.
Identité israélienne et basculement vers une identité juive
Avant l'attaque du 7 octobre, une partie importante de la population israélienne laïque s'identifiait davantage à une identité israélienne moderne, s’éloignant progressivement des références religieuses. Mais dès les premières heures de l'attaque, cette identité israélienne a laissé place à un retour symbolique à l'identité juive. Comme l'a raconté Daniel Haïk, lors de la libération des kibboutzim, les habitants ont ouvert leurs portes aux soldats israéliens seulement après avoir entendu une prière juive emblématique. Cela a marqué un tournant identitaire profond, même parmi les laïcs. "Le 7 octobre il s'est passé quelque chose de particulièrement émouvant, après plusieurs heures d'attente, lorsque les soldats du Tsahal sont arrivés pour libérer les rescapés des Kibboutz, ces derniers ne leur ont pas ouvert les portes de leurs chambres blindées du premier coup, de peur que ce soient des terroristes se faisant passer par des membres de l’armée israélienne. Ils ont ouvert quand les soldats on dit une phrase qui est une phrase symbolique dans l'histoire du peuple juif, le Shema Israël, l'éternel, écoute, Israël éternel notre dieu, l'éternel est un, ils ont donné cette phrase, les laïcs de ces kibboutz retranchés dans leurs chambres blindées, eux, ont ouvert, ils ont compris que c'était des soldats juifs qui venaient les libérer, et quelque part c'est ce que j'appelle, c'est le symbole de ce retour à plus d'identité juive que l'on constate aujourd'hui dans la société israélienne".
Tsahal et les enjeux sécuritaires
L’une des grandes questions qui a émergé après l'attaque fut : Où était Tsahal ? L’armée israélienne, réputée pour sa vigilance et sa capacité à anticiper les menaces, semblait prise au dépourvu ce jour-là. Les failles dans les systèmes de défense et l’absence d’anticipation ont soulevé des interrogations sur la préparation et la capacité de l’armée à répondre à des attaques de grande ampleur, aussi soudaines et coordonnées que celle du Hamas. "La défection des instances militaires a, certes, été compensée par une mobilisation d’individualités qui, avec courage ont volé au secours des habitants des kibboutzim et des jeunes fêtards du festivale Nova. Mais le sacrifice de ces Israéliens téméraires n’a pas pu masquer de terribles carences au sommet de la hiérarchie militaire"
Le peuple israélien entre résilience et unité temporaire ?
Malgré cette résilience impressionnante, une question persiste : cette unité née du 7 octobre pourra-t-elle se maintenir face aux défis à venir, ou est-elle simplement une réaction temporaire à une menace immédiate ? L’avenir de la société israélienne, et son identité, reste en pleine redéfinition, "il y a une forme de résilience que l'on a vu le 8 octobre. Cette société qui était divisée à la veille du 7 octobre, elle s'est soudée et elle a fait face à l'adversité. Elle s'est unifiée, elle s'est ressoudée, elle a fait montre de résilience et c'est extrêmement impressionnant. Il y a des milliers d'exemples de courage, de bravoure et de résilience de la part d'Israël"
RCF vit grâce à vos dons
RCF est une radio associative et professionnelle.
Pour préserver la qualité de ses programmes et son indépendance, RCF compte sur la mobilisation de tous ses auditeurs. Vous aussi participez à son financement !