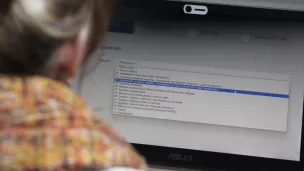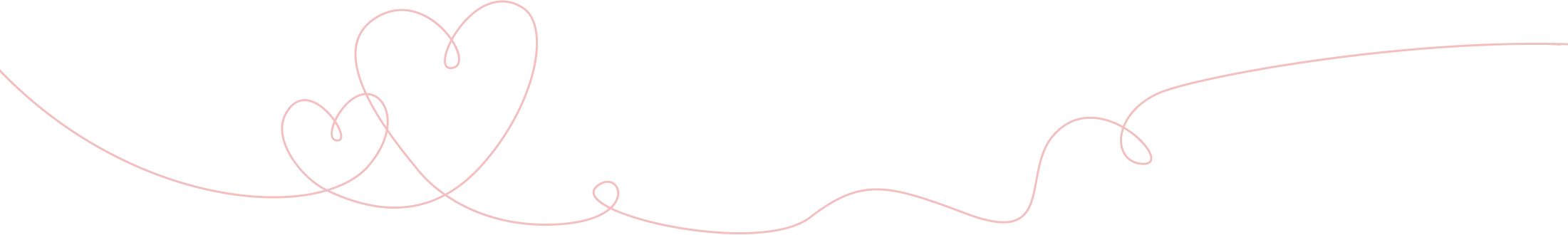Les politiques d'inclusion dans les études supérieures
Aujourd’hui l'Assemblée nationale examine une proposition de loi visant à favoriser l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public. Des discussions sur l’accès aux filières d’études supérieures de prestige alors que les campagnes de candidatures Parcours Sup et MonMaster sont lancées. Alors pour bien comprendre quelle politique d'inclusion sont mise en place dans l’enseignement supérieur, Isabelle Barth, professeure des Universités, chercheuse, et manager spécialiste de l’inclusivité est au micro de RCF et Radio Notre-Dame.
 © Ludovic Godard
© Ludovic Godard L’accès aux études supérieures peut être l’occasion de discrimination ou de reproduction des inégalités. Parce que comme tous les concours, tous les examens, vous souhaitez avoir des élites, c’est l’objectif et vous vous rendez compte petit à petit que vous êtes dans la reproduction sociale. C’est-à-dire que les mêmes personnes arrivent dans ces écoles. Il y a quelques années, les professeurs se sont poser la question de l’élargissement à l’ensemble des étudiants qu'ils allaient accueillir et donc de modifier la façon dont on pouvait accéder à ces écoles. C’est la question que se posent ces écoles de services publics.
L'identification des discriminations
Tout d'abord, rappelons que la discrimination est punie par la loi. Lorsque l’on discrimine, nous nous mettons donc en danger par rapport à la loi. Nous les connaissons, mais ce ne sont pas exactement des discriminations au sens : "tu ne rentres pas dans cette école parce que tu es noir, tu t’appelles Mohammed ou tu n’as pas assez d’argent." Nous partons de l’intelligence, de la connaissance, d’où les concours, les examens, mais finalement, ces concours, ces examens sont discriminants. De plus, quand une école n’est pas publique, par définition, elle est payante. Cela peut discriminer au sens où cela vous oblige à avoir des parents qui ont les moyens financiers de payer pour vos études. Donc, cela vous interdit l’accès à ses écoles. On se rend alors compte que beaucoup de lycéens brillants sont dans l’auto censure par rapport à cet accès à ces écoles. Parce qu'ils ne croient pas en leurs propres chances, ils estiment qu'ils n'ont pas les bagages pour réussir.
On observe aussi d'importantes discriminations sociales. Par exemple, un enfant venant d'une famille ou personne n’a été au-delà du brevet des collèges, alors le baccalauréat, c’est déjà bien, le BTS sera un exploit, alors passer un concours de grande école est impossible, il y a donc une véritable auto-censure même si concrètement, cela est possible. Isabelle Barth témoigne;
J’ai eu beaucoup d’étudiants qui me l’ont raconté
Donc finalement, on peut dire que ce n’est pas seulement une question de carnet de notes, cela ne dépend pas uniquement de nos résultats scolaires.
L'égalité des chances
Je me rappelle d’une étudiante que j’avais eue lorsque je dirigeais une école à Strasbourg qui m’avait dit que c’était plus difficile pour elle de franchir le périphérique que l’Atlantique alors qu’elle avait fait un stage formidable et une année de césure aux Etats-Unis une fois qu’elle avait été à l’école de management de Strasbourg.
Certains étudiants ne sont donc pas dans l’imaginaire de réussir, alors qu'ils ont les compétences. Donc les écoles se disent que c’est tout de même dommage de passer à côté de tous ces talents, de tous ces étudiants brillants pour des questions de censures et d’incompréhension du système. On va donc chercher des solutions pour les amener à passer ces concours et à les réussir souvent très bien.
La discrimination positive
Nous mettons donc en place "l’affirmative action" à l'initiative des Etats-Unis soit la discrimination positive. C’est-à-dire que l’on va mettre en place des concours spécifiques pour que des personnes différentes du portrait classique puissent avoir des voies d’accès qui les favorisent. Cela pourrait notamment être le cas pour des étudiants en situation de handicap. Puis, vous avez la possibilité de suggérer à des lycéens brillants de rejoindre ces écoles. Les écoles mettent en place des dispositifs comme les carnets de la réussite. Des étudiants d’écoles vont rencontrer des lycéens et puis des choses toutes simples comme les emmener au musée, au théâtre. On leur donnent donc cette culture sociale qu’ils n’ont pas au jour le jour. C’est donc une manière d’encourager les étudiants qui n’ont pas ce socle social ou culturel estimé adapté pour entrer dans ces écoles.
La diversité, qui est l’autre regard positif de la discrimination, nous dit que nous avons tout à gagner des personnes différentes, donc des personnes à compétences égales. Il ne s’agit donc pas de recruter des gens moins bons, mais des gens handicapés, des femmes par exemple dans les écoles d’ingénieur, parce que celles ci mettent en place des parcours spéciaux pour avoir plus de femmes. Cela peut aussi être des critères sociaux tels que l’âge, notamment avoir des personnes plus âgées avec des concours spécifiques qui permettent à des personnes de revenir dans ces écoles. C’est donc de l’attractivité, de la créativité, de l’inclusion et puis c’est être le miroir de la société.
Néanmoins, le problème de la discrimination positive est que certaines personnes ont l’impression de laisser passer des personnes qui ne le méritent pas parce qu’ils sont d’origines ethniques différentes, parce qu’ils sont handicapés, parce que ce sont des femmes. Ceux qui occupent les places restantes disent donc que l’on leur prend leurs places. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre dans l'utilisation de cette discrimination positive afin que chacun ait une chance de pouvoir accéder à ces écoles.
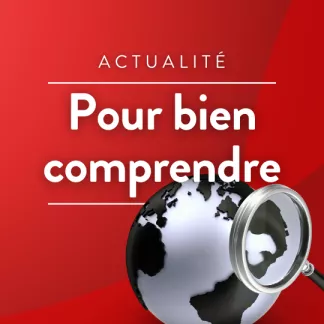

Pour bien comprendre l'actualité, il faut la décoder. Chaque matin, les journalistes analysent, accompagnés d’un expert, un fait d’actualité pour en identifier tous les enjeux.