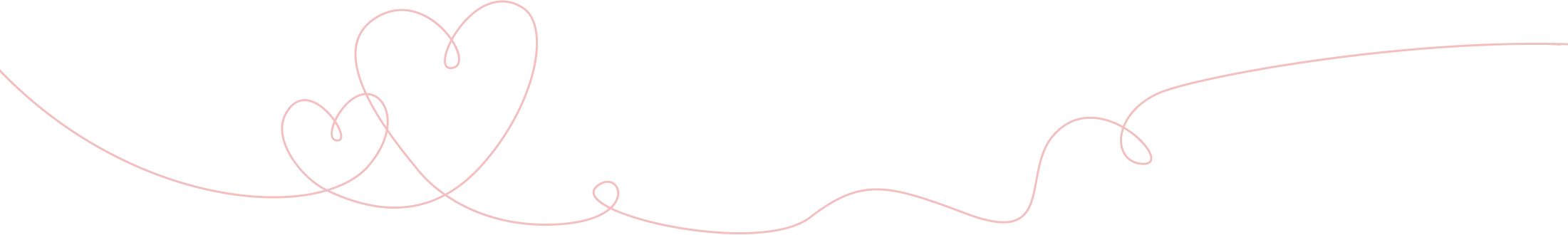L'agence de l'eau : au service de la ressource pour 2025-20230
L'Agence de l'eau Loire-Bretagne lance un programme d'intervention pour les années 2025-2030 Olivier Raynard, directeur de la délégation Poitou-Limousin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne nous en décrit les contours.
 Le Clain vu du pont St Cyprien à Poitiers
Le Clain vu du pont St Cyprien à PoitiersOlivier Raynard, en quoi consiste ce programme qui est le douzième en la matière et dont le budget s'élève à 2,5 milliards d'euros ?
Il s'agit de mobiliser cet argent pour développer et aider à améliorer la qualité de l'eau, à améliorer sa disponibilité en quantité, à améliorer aussi la qualité des milieux, des écosystèmes, des zones humides, des cours d'eau, de la biodiversité associée et également à mettre en place les conditions d'une gestion partagée de l'eau entre les différents usages. Tout cela déployé sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, qui va du Mont-Saint-Michel jusqu'au sud de la Rochelle et de Brest à Saint-Étienne.
À qui attribuez vous ces aides ?
A l'ensemble des structures qui vont travailler pour améliorer la situation en matière d'eau. Donc on va retrouver des collectivités locales, des communes, des établissements de coopération intercommunale comme des communautés d'agglomération, des communautés de communes qui vont être en charge de l'assainissement par exemple ou de l'eau potable. On va travailler également avec des syndicats de rivières pour améliorer l'état écologique des cours d'eau, avec des syndicats d'eau potable pour améliorer la qualité des eaux brutes que ces syndicats captent pour ensuite passer l'eau et traiter l'eau dans des usines d'eau potable et enfin les distribuer aux habitants et aux différents usagers. On accompagne également financièrement des associations qui vont contribuer à protéger la biodiversité, à agir sur les cours d'eau et des structures qui vont rassembler l'ensemble des usagers pour essayer de mieux gérer l'eau ensemble aujourd'hui et à l'avenir.
Pourquoi un tel programme ? Quel était le constat en fait ?
Sur le territoire Poitou-Limousin, aujourd'hui on peut considérer qu'il y a 27% des cours d'eau qui sont en bon état écologique. Cela veut dire que ceux qui n'atteignent pas ce bon état sont dégradés sur trois points principaux. Le premier et le plus important, c'est l'hydrologie, le fait que les cours d'eau manquent d'eau en période estivale, le fait que les débits baissent fortement en période estivale. La deuxième source de dégradation pour ces cours d'eau, c'est la façon avec laquelle on a aménagé ces cours d'eau, c'est-à-dire leur morphologie. Des cours d'eau sont parfois très rectilignes, alors qu'auparavant, avant l'action de l'homme, ils étaient beaucoup plus méandrés, ou avec des fonds très envasés, alors qu'il faudrait mieux trouver des fonds avec une granulométrie plus importante, des graviers par exemple, qui permettent à l'ensemble de la vie de mieux s'installer. Et puis enfin, la présence de substances liées à des pollutions diffuses comme les nitrates, les pesticides. Et donc, le programme de l'agence vise différents objectifs : Un, améliorer l'état écologique des cours d'eau, mais également l'état des nappes phréatiques et des plans d'eau. Deux, permettre aux collectivités, à l'ensemble des collectivités territoriales, de s'adapter aux dérèglements climatiques. Trois, agir pour améliorer les cours d'eau, faire en sorte qu'on retrouve des équilibres sur des bassins versants ; un équilibre qui permet en fait à la ressource disponible de couvrir les usages. Et enfin, le dernier point, c'est d'accompagner tout un tas d'actions qui vont permettre d'améliorer la qualité des eaux dans les nappes et dans les cours d'eau, pour plus facilement produire de l'eau potable. Donc y retrouver moins de pesticides et moins de nitrates.
Concrètement, comment on restaure un cours d'eau ? Quels sont les aménagements qui peuvent être mis en œuvre ?
On fait surtout appel à la nature, parce que la nature peut nous enseigner. Donc, restaurer un cours d'eau, ça peut être aider ce cours d'eau à s'autonettoyer ; remettre à certains endroits des enrochements, remettre à certains endroits ce qu'on appelle de la ripisylve, c'est-à-dire planter des arbres le long de ces cours d'eau, recréer des zones de frayère où les poissons vont pouvoir se reproduire plus facilement, remettre du courant dans les cours d'eau, c'est-à-dire à certains moments, restreindre un petit peu la largeur du cours d'eau, pour que celui-ci puisse permettre une accélération du courant et qui dit courant, dit auto-nettoyage du fond.
D'autres actions également peuvent être mises en place, notamment la restauration de zones humides. Beaucoup de prairies humides ou de zones un peu marécageuses ont pu être drainées. Et donc, les restaurer dans leur fonctionnement, ça permet de faire en sorte qu'elles peuvent resservir d'éponge naturelle, c'est-à-dire qu'elles ont la faculté d'absorber l'eau quand elle est très en excès, en période de crues par exemple, et elles vont ensuite rediffuser, relarguer de l'eau de façon très progressive, au moment où l'eau se fait plus rare dans le cours d'eau et que son niveau baisse.
Donc ce sont des zones qui permettent d'accompagner naturellement les débits des cours d'eau en période estivale et en période de sécheresse.
Ça, ça passe par des choix politiques, de préserver les zones humides, ça veut dire que vous avez des garanties de la part des collectivités locales sur ces territoires ?
C'est une politique qui peut effectivement être déployée par une collectivité locale, mais également par des associations qui achètent des zones de prairies humides pour parfois les restaurer, parfois les protéger. Et puis enfin, on a aussi des initiatives privées. Je pense notamment à des fédérations de pêche qui parfois ont en propriété des plans d'eau et qui décident d'effacer ces plans d'eau pour recréer une zone humide avec des mares et des zones qui sont inondables en fonction de la pluviométrie et qui sont en fait des zones très riches. Et on a des exemples de cette nature qui ont été réalisés ; en Deux-Sèvres par exemple, par la fédération de pêche et qui donnent des résultats très intéressants. En l'espace d'un an,la zone humide se reconstitue avec des roselières, avec des espèces végétales adaptées au milieu humide et on a pu se développer de façon importante les pontes de batracien. La fédération de pêche a montré qu'en 2024, notamment sur toute la période pluvieuse, cette zone humide a vraiment joué son rôle d'éponge et d'écrêteur de crues six ou sept fois. La nature peut reprendre ses droits très rapidement et c'est vraiment, comme vous le disiez, une politique d'aménagement du territoire qu'il faut peut-être réadapter à l'aune du changement climatique.
Et les réserves de substitution dans ce programme, quelle est leur place ?
( rire) Je savais que vous alliez me poser la question.
On est sur un territoire où ça cristallise un peu les passions !
Oui, notamment sur la Sèvres Niortaise et sur le bassin du Clain qui sont des bassins qui sont en déséquilibre quantitatif, c'est-à-dire que depuis de nombreuses années, les usages sont plus importants en terme de prélèvement que ce que la nature peut fournir. Pour l'Agence de l'eau, le stockage peut être une solution, ça fait partie de son programme d'aide, mais en aucun cas, il ne constitue LA solution. En fait, ces réserves n'ont de sens que si des évolutions de pratiques agricoles qui permettent d'être moins dépendants de l'irrigation, Une technique qu'on appelle de l'agroécologie est menée en parallèle. C'est-à-dire à travailler avec les plantes, avec des sols, avec des sols les plus vivants possibles. Avec ce type d'agriculture, on peut avoir des sols qui vont mieux retenir l'eau, mieux l'infiltrer vers les nappes, au lieu que cette eau ruisselle et rejoigne directement les cours d'eau. Il y a tout un tas de techniques qui sont accompagnées par l'Agence de l'eau, à travers, par exemple, la conversion à l'agriculture biologique, à travers des mesures agro-environnementales, à travers la mise en place de couvertures intégrales des sols, qui font qu'on ne retrouve quasiment plus de sols nus, y compris en hiver, et systématiquement un couvert végétal qui va permettre l'infiltration douce et très progressive de l'eau vers les nappes.
Des mesures qui font partie de ce programme d'intervention 2025-2030.



Chaque jour de la semaine, un sujet d’actu avec un invité interviewé par chaque radio RCF de Nouvelle Aquitaine.